
|
Consulter
le sommaire Orthotypo en librairie
au responsable du site
(Pour poser une question, suggérer une amélioration ou signaler une coquille) Typographie, choix éditoriaux, et brève histoire de… l’Opus Lacroussianum Magnum Ce site web et les fichiers qu’il contient sont placés sous Licence Creative Commons (by-nc-nd) |
|
Académie
![]() Majuscule.
Majuscule.
« L’Académie
a un grand malheur, c’est
d’être la seule corporation un peu durable
qui n’ait jamais cessé d’être ridicule. »
Alfred de VIGNY,
Journal d’un poète.
![]() L’usage
— chaotique — interdit d’appliquer bonnement les règles générales
relatives aux institutions et aux organismes. C’est regrettable,
bien qu’un soupçon d’académisme ne soit pas ici inadéquat.
L’usage
— chaotique — interdit d’appliquer bonnement les règles générales
relatives aux institutions et aux organismes. C’est regrettable,
bien qu’un soupçon d’académisme ne soit pas ici inadéquat.
![]() Les
occurrences non problématiques sont par bonheur les plus
nombreuses. Dans ses emplois de strict nom commun,
« académie » s’écrit évidemment avec une minuscule
initiale.
Les
occurrences non problématiques sont par bonheur les plus
nombreuses. Dans ses emplois de strict nom commun,
« académie » s’écrit évidemment avec une minuscule
initiale.
![]() Exemple.
— Il fréquente une académie de dessin où il dessine des
académies et peint des natures mortes.
Exemple.
— Il fréquente une académie de dessin où il dessine des
académies et peint des natures mortes.
![]() Pris
absolument (l’Académie) ou désignant une institution nationale,
déterminée par un nom commun (l’Académie des sciences) ou un
adjectif (l’Académie française), le mot académie prend une
majuscule initiale.
Pris
absolument (l’Académie) ou désignant une institution nationale,
déterminée par un nom commun (l’Académie des sciences) ou un
adjectif (l’Académie française), le mot académie prend une
majuscule initiale.
![]() Pour
le reste, les avis sont partagés (voir : § 2).
Comme toujours, deux tendances s’affrontent : la cohérence
contre l’élégance, la logique contre la grâce, la grammaire contre
la typographie, la majuscule souveraine contre la minuscule
subtile, l’Académie Goncourt contre l’académie Goncourt. Il est
fâcheux de privilégier une vertu aux dépens d’une autre. Pourtant,
il le faut, car emprunter une voie médiane ne simplifie rien et
additionne aussi les vices. La règle énoncée ci-dessous respecte
la grande tradition typographique française, que, selon l’humeur
du jour, on trouvera byzantine ou raffinée.
Pour
le reste, les avis sont partagés (voir : § 2).
Comme toujours, deux tendances s’affrontent : la cohérence
contre l’élégance, la logique contre la grâce, la grammaire contre
la typographie, la majuscule souveraine contre la minuscule
subtile, l’Académie Goncourt contre l’académie Goncourt. Il est
fâcheux de privilégier une vertu aux dépens d’une autre. Pourtant,
il le faut, car emprunter une voie médiane ne simplifie rien et
additionne aussi les vices. La règle énoncée ci-dessous respecte
la grande tradition typographique française, que, selon l’humeur
du jour, on trouvera byzantine ou raffinée.
![]() 1.1.
•••
Le mot académie prend une majuscule initiale…
1.1.
•••
Le mot académie prend une majuscule initiale…
![]() 1.1.1.
Lorsqu’il est pris au sens absolu (l’Académie) ;
emploi réservé — en principe — à l’Académie française et aux
Académies platoniciennes : l’Académie travaille, dit-on, à un
dictionnaire ; le Dictionnaire de l’Académie est en
lente gestation ; l’Ancienne Académie.
1.1.1.
Lorsqu’il est pris au sens absolu (l’Académie) ;
emploi réservé — en principe — à l’Académie française et aux
Académies platoniciennes : l’Académie travaille, dit-on, à un
dictionnaire ; le Dictionnaire de l’Académie est en
lente gestation ; l’Ancienne Académie.
![]() 1.1.2.
Lorsqu’il désigne une société savante (au sens large…),
déterminée par un nom commun : l’Académie d’agriculture,
l’Académie d’architecture (de marine, des sports, etc.),
l’Académie de chirurgie (de médecine, de pharmacie, etc.),
l’Académie des sciences de Berlin (de Cracovie, du Kazakhstan,
etc.) ou par un adjectif : l’Académie britannique, l’Académie
florentine (française, palatine, etc.), l’Académie romaine
pontificale d’histoire et d’archéologie, l’Académie royale de
peinture et de sculpture (de danse, de musique), l’Académie royale
espagnole, l’Académie royale de langue et de littérature française
de Belgique.
1.1.2.
Lorsqu’il désigne une société savante (au sens large…),
déterminée par un nom commun : l’Académie d’agriculture,
l’Académie d’architecture (de marine, des sports, etc.),
l’Académie de chirurgie (de médecine, de pharmacie, etc.),
l’Académie des sciences de Berlin (de Cracovie, du Kazakhstan,
etc.) ou par un adjectif : l’Académie britannique, l’Académie
florentine (française, palatine, etc.), l’Académie romaine
pontificale d’histoire et d’archéologie, l’Académie royale de
peinture et de sculpture (de danse, de musique), l’Académie royale
espagnole, l’Académie royale de langue et de littérature française
de Belgique.
![]() 1.1.3.
Lorsqu’il désigne une institution nationale unique,
quelle que soit la nature du déterminant : l’Académie
d’Italie, l’Académie de France à Rome, l’Académie d’armes
(institution unique, mais une académie d’armes ou l’académie
d’armes du coin).
1.1.3.
Lorsqu’il désigne une institution nationale unique,
quelle que soit la nature du déterminant : l’Académie
d’Italie, l’Académie de France à Rome, l’Académie d’armes
(institution unique, mais une académie d’armes ou l’académie
d’armes du coin).
![]() Ces
critères peuvent se superposer : l’Académie française est une
institution nationale unique et une société savante déterminée par
un adjectif.
Ces
critères peuvent se superposer : l’Académie française est une
institution nationale unique et une société savante déterminée par
un adjectif.
![]() 1.2.
•••
Dans tous les autres cas, la minuscule initiale s’impose.
1.2.
•••
Dans tous les autres cas, la minuscule initiale s’impose.
![]() Société
savante déterminée par un nom propre (ou une dénomination
assimilée à un nom propre) et n’ayant pas le caractère d’une
institution unique : l’académie Goncourt (Dupont, Julian,
Untel, etc.), l’académie de Sainte-Cécile, ± l’académie des Jeux
floraux (voir : Jeu).
Société
savante déterminée par un nom propre (ou une dénomination
assimilée à un nom propre) et n’ayant pas le caractère d’une
institution unique : l’académie Goncourt (Dupont, Julian,
Untel, etc.), l’académie de Sainte-Cécile, ± l’académie des Jeux
floraux (voir : Jeu).
![]() Circonscription
universitaire française, anciennes universités :
l’académie d’Aix-Marseille (de Nancy, de Poitiers, de Toulouse,
etc.), les académies protestantes.
Circonscription
universitaire française, anciennes universités :
l’académie d’Aix-Marseille (de Nancy, de Poitiers, de Toulouse,
etc.), les académies protestantes.
![]() Lieu,
école ou établissement où l’on pratique un art, un sport, un jeu
et n’ayant pas le caractère d’une institution unique : une
académie de billard, une académie d’armes (de danse, de dessin,
d’escrime, d’équitation, de peinture, etc.), l’académie
Charpentier.
Lieu,
école ou établissement où l’on pratique un art, un sport, un jeu
et n’ayant pas le caractère d’une institution unique : une
académie de billard, une académie d’armes (de danse, de dessin,
d’escrime, d’équitation, de peinture, etc.), l’académie
Charpentier.
![]()
![]() Nom commun non déterminé : à quoi servent donc les
académies ?
Nom commun non déterminé : à quoi servent donc les
académies ?
![]()
![]() Œuvre représentant un nu : une belle académie de Boucher.
Œuvre représentant un nu : une belle académie de Boucher.
![]()
![]() Extension de sens : elle a une très chouette académie.
Extension de sens : elle a une très chouette académie.
![]() Emploi
au sens absolu : il est traditionnellement réservé à
l’Académie (athénienne), fondée par Platon sous les platanes du
jardin d’Akadêmos, et à l’Académie (française), fondée par
Richelieu et fréquentée depuis par des académiciens.
Emploi
au sens absolu : il est traditionnellement réservé à
l’Académie (athénienne), fondée par Platon sous les platanes du
jardin d’Akadêmos, et à l’Académie (française), fondée par
Richelieu et fréquentée depuis par des académiciens.
![]() ••
Source de clarté, ce privilège ne devrait pas être aboli.
••
Source de clarté, ce privilège ne devrait pas être aboli.
![]() •
Toutefois, si le contexte élimine les risques de confusion, rien
n’interdit de l’étendre occasionnellement à d’autres Académies qui
bénéficient de la majuscule initiale (voir : § 1.1.2
et 1.1.3).
•
Toutefois, si le contexte élimine les risques de confusion, rien
n’interdit de l’étendre occasionnellement à d’autres Académies qui
bénéficient de la majuscule initiale (voir : § 1.1.2
et 1.1.3).
![]()
![]() •
L’Académie désigne parfois l’Institut de France, mais c’est
introduire une ambiguïté inutile puisque nous avons l’Institut
(institution et bâtiment).
•
L’Académie désigne parfois l’Institut de France, mais c’est
introduire une ambiguïté inutile puisque nous avons l’Institut
(institution et bâtiment).
![]() Institut
de France (l’Institut) : Académie française,
Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des
sciences, Académie des beaux-arts, Académie des sciences morales
et politiques.
Institut
de France (l’Institut) : Académie française,
Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des
sciences, Académie des beaux-arts, Académie des sciences morales
et politiques.
![]() Circonscriptions
universitaires : la minuscule s’impose depuis
longtemps : l’académie de Lille, un inspecteur d’académie.
Circonscriptions
universitaires : la minuscule s’impose depuis
longtemps : l’académie de Lille, un inspecteur d’académie.
![]()
![]() Gouriou
1990, Guéry
1996, Hachette 1995,
Hanse 1987,
Impr. nat. 1990,
Larousse
1885, 1904,
1933,
1970,
Lexis 1989,
Robert 1993.
Gouriou
1990, Guéry
1996, Hachette 1995,
Hanse 1987,
Impr. nat. 1990,
Larousse
1885, 1904,
1933,
1970,
Lexis 1989,
Robert 1993.
![]()
![]() Robert
1985 [Académie de Strasbourg].
Robert
1985 [Académie de Strasbourg].
![]() Palmes
académiques : elles obéissent à la règle commune
(ordre, depuis 1955) : l’ordre des Palmes académiques,
officier des Palmes académiques ; à lui la palme, il a eu les
Palmes ! (voir : Décoration, Ordre).
Palmes
académiques : elles obéissent à la règle commune
(ordre, depuis 1955) : l’ordre des Palmes académiques,
officier des Palmes académiques ; à lui la palme, il a eu les
Palmes ! (voir : Décoration, Ordre).
![]()
![]() Code typ. 1993,
Girodet
1988, Impr. nat. 1990,
Larousse 1970,
1992,
Zacharia
1987.
Code typ. 1993,
Girodet
1988, Impr. nat. 1990,
Larousse 1970,
1992,
Zacharia
1987.
![]()
![]() Hanse 1987
{palmes académiques}, Robert 1985,
1993
{les palmes}.
Hanse 1987
{palmes académiques}, Robert 1985,
1993
{les palmes}.
![]() Goncourt :
face à celle des Quarante, Edmond de Goncourt fonda par
testament une académie composée de dix romanciers, connue depuis
sous le nom d’académie des Goncourt (forme désuète) ou,
aujourd’hui, d’académie Goncourt (forme recommandée). Elle décerne
le prix Goncourt. On peut trouver chez les plus grands écrivains
mille et un exemples pour défendre et justifier la majuscule
initiale d’{Académie} : la méthode s’applique à quantité
d’archaïsmes, voire à des formes depuis des décennies fautives.
L’orthotypographie de René Étiemble (Universalis
1990) est irréprochable : « Qui sait même
si, à côté des centaines de navets qu’elle a suscités dans
l’esprit du prix qui enrichit son homme, l’académie Goncourt n’a
pas fait germer un bon livre (ou même deux) ? »
Goncourt :
face à celle des Quarante, Edmond de Goncourt fonda par
testament une académie composée de dix romanciers, connue depuis
sous le nom d’académie des Goncourt (forme désuète) ou,
aujourd’hui, d’académie Goncourt (forme recommandée). Elle décerne
le prix Goncourt. On peut trouver chez les plus grands écrivains
mille et un exemples pour défendre et justifier la majuscule
initiale d’{Académie} : la méthode s’applique à quantité
d’archaïsmes, voire à des formes depuis des décennies fautives.
L’orthotypographie de René Étiemble (Universalis
1990) est irréprochable : « Qui sait même
si, à côté des centaines de navets qu’elle a suscités dans
l’esprit du prix qui enrichit son homme, l’académie Goncourt n’a
pas fait germer un bon livre (ou même deux) ? »
![]() Compréhensible
sous la plume des premiers membres (Jules Renard, par exemple),
l’emploi absolu systématique avec la majuscule initiale semble
aujourd’hui abusif : « Hervé Bazin, pas plus que
Colette, n’aura jamais le Prix [> prix], mais il s’en
consolera en devenant, comme elle, président de l’Académie
[> académie]. » – Michel TOURNIER,
de l’académie Goncourt, le Vol du vampire.
Compréhensible
sous la plume des premiers membres (Jules Renard, par exemple),
l’emploi absolu systématique avec la majuscule initiale semble
aujourd’hui abusif : « Hervé Bazin, pas plus que
Colette, n’aura jamais le Prix [> prix], mais il s’en
consolera en devenant, comme elle, président de l’Académie
[> académie]. » – Michel TOURNIER,
de l’académie Goncourt, le Vol du vampire.
![]()
![]() Code typ. 1993,
Hachette 1995,
Impr. nat. 1990,
Larousse 1933,
Micro-Robert 1990 :
académie Goncourt.
Code typ. 1993,
Hachette 1995,
Impr. nat. 1990,
Larousse 1933,
Micro-Robert 1990 :
académie Goncourt.
![]()
![]() Larousse
1985, Larousse
mens. (mars 1908) : académie des Goncourt.
Larousse
1985, Larousse
mens. (mars 1908) : académie des Goncourt.
![]()
![]() Larousse
1904, 1970,
1999 :
{Académie des Goncourt}.
Larousse
1904, 1970,
1999 :
{Académie des Goncourt}.
![]()
![]() Doppagne
1991,
Gouriou
1990, Robert
1994, la plupart des écrivains membres de cette
académie et certains de ceux qui souhaitent la rejoindre ou
obtenir son prix annuel : {Académie Goncourt}.
Doppagne
1991,
Gouriou
1990, Robert
1994, la plupart des écrivains membres de cette
académie et certains de ceux qui souhaitent la rejoindre ou
obtenir son prix annuel : {Académie Goncourt}.
![]() Il
est certain que les options retenues ici peuvent être légitimement
critiquées. Encore convient-il de bien choisir ses arguments. Les
partisans de l’uniformité en avancent parfois d’étranges. Doppagne
1991 nous met en garde : « La masse ne
comprendra pas ou ne retiendra pas qu’il faut écrire Académie
française mais académie Goncourt […]. »
Il
est certain que les options retenues ici peuvent être légitimement
critiquées. Encore convient-il de bien choisir ses arguments. Les
partisans de l’uniformité en avancent parfois d’étranges. Doppagne
1991 nous met en garde : « La masse ne
comprendra pas ou ne retiendra pas qu’il faut écrire Académie
française mais académie Goncourt […]. »
![]() Je
suis persuadé que « la masse » sait encore faire la
différence entre un adjectif et un patronyme, entre une
institution dont le caractère unique paraît indubitable et un club
de romanciers, et qu’il n’est pas raisonnable, surtout pour un
grammairien, de s’imaginer le contraire.
Je
suis persuadé que « la masse » sait encore faire la
différence entre un adjectif et un patronyme, entre une
institution dont le caractère unique paraît indubitable et un club
de romanciers, et qu’il n’est pas raisonnable, surtout pour un
grammairien, de s’imaginer le contraire.
![]() Le
couple Académie de marine – musée de la Marine est certes
troublant pour les amateurs d’uniformité mais il respecte une loi
non écrite — une « tendance lourde » —, celle qui,
tenant compte de la perception des masses, assimile certains
« organismes » à des lieux (voir : Majuscule).
Le
couple Académie de marine – musée de la Marine est certes
troublant pour les amateurs d’uniformité mais il respecte une loi
non écrite — une « tendance lourde » —, celle qui,
tenant compte de la perception des masses, assimile certains
« organismes » à des lieux (voir : Majuscule).
Accentuation
![]() Abréviation,
Capitale,
Chimie, Index,
Ligature,
Majuscule,
Sigle,
Transcription,
translittération, Unité
de mesure.
Abréviation,
Capitale,
Chimie, Index,
Ligature,
Majuscule,
Sigle,
Transcription,
translittération, Unité
de mesure.
« Les
accents ne sont-ils pas comme des adieux,
les dernières notations musicales de notre alphabet
déchiré ?
C’est par eux, par ces touches sonores qui se posent
sur les lignes que nos livres relèvent encore de la
musique. »
Jérôme PEIGNOT,
De l’écriture à la typographie.
1. •• Accents sur les majuscules.
![]() Aujourd’hui,
les majuscules doivent être accentuées, que le texte soit COMPOSÉ
EN CAPITALES, COMPOSÉ
EN PETITES CAPITALES,
composé en bas de casse (les majuscules initiales étant
accentuées).
Aujourd’hui,
les majuscules doivent être accentuées, que le texte soit COMPOSÉ
EN CAPITALES, COMPOSÉ
EN PETITES CAPITALES,
composé en bas de casse (les majuscules initiales étant
accentuées).
![]()
![]() Code
typ. 1993, Frey
1857, Gouriou
1990, Grevisse
1986, Guéry
1996,
Impr. nat. 1990,
Perrousseaux 1995,
Richaudeau 1989,
Williams 1992.
Code
typ. 1993, Frey
1857, Gouriou
1990, Grevisse
1986, Guéry
1996,
Impr. nat. 1990,
Perrousseaux 1995,
Richaudeau 1989,
Williams 1992.
![]()
![]() La quasi-totalité de la presse et une part croissante de
l’édition.
La quasi-totalité de la presse et une part croissante de
l’édition.
![]() « Il
est dans un [etat] lamentable » choquera le premier lecteur
venu, qui relèvera immédiatement une faute d’orthographe.
« Les [Etats-Unis] sont dans une situation enviable » ne
troublera pas grand monde ; quelques pinailleurs noteront une
petite négligence, aujourd’hui bien courante. Or il s’agit de la
même faute. Pourquoi une faute inadmissible sur une minuscule
deviendrait-elle vénielle, admissible, voire recommandée sur une
majuscule ? Les capitales accentuées supportent mal la
réduction de l’interlignage ? Certaines polices n’offrent pas
tous les caractères accentués du français, d’autres en sont
totalement dépourvues ? « É » ne se frappe pas
aisément sur un clavier d’ordinateur ? Qu’à cela ne
tienne ! répliquent les esprits entreprenants, changeons la
langue, le problème sera résolu. D’où les [A mon sens], [Etre
présent au monde], [Ecoles de gestion], [Ile de Ré] qui
fleurissent dans la prose commerciale, publicitaire,
administrative, religieuse, dans la presse ou la correspondance
privée, voire dans quelques livres. L’influence
« néfaste » des machines à écrire est une explication
commune, répétée à l’envi, qui ne tient pas debout : pendant
le siècle où elles furent en usage, on n’a pas constaté la
raréfaction progressive de toutes les richesses typographiques
qu’elles étaient incapables de reproduire. On a même assisté au
phénomène inverse.
« Il
est dans un [etat] lamentable » choquera le premier lecteur
venu, qui relèvera immédiatement une faute d’orthographe.
« Les [Etats-Unis] sont dans une situation enviable » ne
troublera pas grand monde ; quelques pinailleurs noteront une
petite négligence, aujourd’hui bien courante. Or il s’agit de la
même faute. Pourquoi une faute inadmissible sur une minuscule
deviendrait-elle vénielle, admissible, voire recommandée sur une
majuscule ? Les capitales accentuées supportent mal la
réduction de l’interlignage ? Certaines polices n’offrent pas
tous les caractères accentués du français, d’autres en sont
totalement dépourvues ? « É » ne se frappe pas
aisément sur un clavier d’ordinateur ? Qu’à cela ne
tienne ! répliquent les esprits entreprenants, changeons la
langue, le problème sera résolu. D’où les [A mon sens], [Etre
présent au monde], [Ecoles de gestion], [Ile de Ré] qui
fleurissent dans la prose commerciale, publicitaire,
administrative, religieuse, dans la presse ou la correspondance
privée, voire dans quelques livres. L’influence
« néfaste » des machines à écrire est une explication
commune, répétée à l’envi, qui ne tient pas debout : pendant
le siècle où elles furent en usage, on n’a pas constaté la
raréfaction progressive de toutes les richesses typographiques
qu’elles étaient incapables de reproduire. On a même assisté au
phénomène inverse.
![]() [Ecriture]
ou [Ecole] sont des graphies défectueuses mais peu
dangereuses : les noms communs ne figurent pas toujours en
début de phrase ; dans la plupart de leurs occurrences, ils
sont intégralement composés en bas de casse et recouvrent leur
accent. Les noms propres n’ont pas cette chance. Composer
systématiquement [Ebre] ou [Erasme] est une singulière façon
d’apprendre aux écoliers qu’il convient d’écrire : Èbre,
Érasme… Nul n’a le droit de reprocher à un élève d’écrire [Erato]
dès lors que le malheureux reproduit fidèlement la seule graphie
qu’il lui ait été donné de lire. Dans un dictionnaire, l’absence
de capitales accentuées est une monstruosité : la Délégation
générale à la langue française, organisme officiel dont le nom est
explicite, s’est déshonorée — le mot est ridiculement faible — en
publiant un Dictionnaire
des termes officiels de la langue française qui en est
totalement dépourvu.
[Ecriture]
ou [Ecole] sont des graphies défectueuses mais peu
dangereuses : les noms communs ne figurent pas toujours en
début de phrase ; dans la plupart de leurs occurrences, ils
sont intégralement composés en bas de casse et recouvrent leur
accent. Les noms propres n’ont pas cette chance. Composer
systématiquement [Ebre] ou [Erasme] est une singulière façon
d’apprendre aux écoliers qu’il convient d’écrire : Èbre,
Érasme… Nul n’a le droit de reprocher à un élève d’écrire [Erato]
dès lors que le malheureux reproduit fidèlement la seule graphie
qu’il lui ait été donné de lire. Dans un dictionnaire, l’absence
de capitales accentuées est une monstruosité : la Délégation
générale à la langue française, organisme officiel dont le nom est
explicite, s’est déshonorée — le mot est ridiculement faible — en
publiant un Dictionnaire
des termes officiels de la langue française qui en est
totalement dépourvu.
![]() On
prétend parfois que les accents purement diacritiques peuvent être
omis sans dommage sur les capitales, car ils ne modifient pas la
prononciation et ne fournissent qu’une information superflue. Le
cas le plus fréquent est bien sûr la préposition « À »
qui, en tête de phrase, ne risque guère d’être confondue avec
l’auxiliaire « avoir » (même dans des occurrences comme
celle-ci : « A voté ! — À voir ! »).
Cette licence est aujourd’hui condamnable, car elle perpétue une
exception qui a perdu son alibi technique.
On
prétend parfois que les accents purement diacritiques peuvent être
omis sans dommage sur les capitales, car ils ne modifient pas la
prononciation et ne fournissent qu’une information superflue. Le
cas le plus fréquent est bien sûr la préposition « À »
qui, en tête de phrase, ne risque guère d’être confondue avec
l’auxiliaire « avoir » (même dans des occurrences comme
celle-ci : « A voté ! — À voir ! »).
Cette licence est aujourd’hui condamnable, car elle perpétue une
exception qui a perdu son alibi technique.
![]()
![]() Impr. nat. 1990.
Impr. nat. 1990.
![]() Outre
l’orthographe, le défaut d’accentuation met à mal la clarté des
messages écrits : LE
MODELE DU COLON :
le modèle du colon (ou du côlon ?), le modelé du côlon (ou du
colon ?).
Outre
l’orthographe, le défaut d’accentuation met à mal la clarté des
messages écrits : LE
MODELE DU COLON :
le modèle du colon (ou du côlon ?), le modelé du côlon (ou du
colon ?).
![]() Autres
exemples classiques. — LES
FORBANS SERONT JUGES. LE MAGASIN FERME A CAUSE DES EMEUTES. LES
INTERNES DENONCENT LE BEURRE SALE. UNE VILLE DE CONGRES. LE
SECRETAIRE D’ETAT CHAHUTE A L’ASSEMBLEE. UN SOLDAT ASSASSINE SUR
ORDRE. IL CROIT SELON LA NORME. UN ROMAN ILLUSTRE. GARAGES
COUVERTS ET FERMES A LOUER. DES ENFANTS SINISTRES, DES PARENTS
INDIGNES. JE ME SUIS TUE. MON BEAUJOLAIS EST LIQUIDE !
Autres
exemples classiques. — LES
FORBANS SERONT JUGES. LE MAGASIN FERME A CAUSE DES EMEUTES. LES
INTERNES DENONCENT LE BEURRE SALE. UNE VILLE DE CONGRES. LE
SECRETAIRE D’ETAT CHAHUTE A L’ASSEMBLEE. UN SOLDAT ASSASSINE SUR
ORDRE. IL CROIT SELON LA NORME. UN ROMAN ILLUSTRE. GARAGES
COUVERTS ET FERMES A LOUER. DES ENFANTS SINISTRES, DES PARENTS
INDIGNES. JE ME SUIS TUE. MON BEAUJOLAIS EST LIQUIDE !
![]() « IL
LAVAIT LES PECHES AINSI QUE DES LIMONS. » – Victor
HUGO,
la Fin de Satan.
« IL
LAVAIT LES PECHES AINSI QUE DES LIMONS. » – Victor
HUGO,
la Fin de Satan.
![]() « LES
LETTRES AIMENT LES VERGES ET LES COUCHES ILLUSTRES. »
– Jacques BERTIN
&
Jacques JOUET,
le Palais des congres.
« LES
LETTRES AIMENT LES VERGES ET LES COUCHES ILLUSTRES. »
– Jacques BERTIN
&
Jacques JOUET,
le Palais des congres.
![]() Anecdote.
— Il y a quelques années, un musée des sciences et de
l’industrie proposa des « billets couplés » avec une
salle de spectacle. Ne possédant pas de capitales accentuées, les
panneaux lumineux affichèrent : BILLETS
COUPLES. De
nombreux couples s’étant présentés dans l’espoir de bénéficier
d’un tarif réduit, on décida de modifier le message et l’on
proposa des « billets combinés », qui, faute d’accent,
intriguèrent plus d’un visiteur.
Anecdote.
— Il y a quelques années, un musée des sciences et de
l’industrie proposa des « billets couplés » avec une
salle de spectacle. Ne possédant pas de capitales accentuées, les
panneaux lumineux affichèrent : BILLETS
COUPLES. De
nombreux couples s’étant présentés dans l’espoir de bénéficier
d’un tarif réduit, on décida de modifier le message et l’on
proposa des « billets combinés », qui, faute d’accent,
intriguèrent plus d’un visiteur.
![]()
![]() Attention !… S’il est erroné de prétendre que la
non-accentuation des capitales est une licence typographique
accordée de longue date, il serait téméraire d’affirmer que
l’accentuation de toutes les voyelles capitales est une
très ancienne tradition… Les accents n’ont pas eu des naissances
concomitantes et, selon les voyelles qu’ils modifiaient, ils
s’imposèrent plus ou moins lentement. Les « A, I, O, U »
furent rarement accentués par les graveurs de caractères — ces
« accents » n’existaient pas dans les fontes de labeur
—, mais les « É, È, Ê » furent toujours respectés. Les
capitales accentuées comptaient parmi les lettres les plus
délicates à fondre, les plus chères et les plus fragiles de la
casse romaine, car l’étroitesse du talus supérieur imposait un
crénage (partie de l’œil qui déborde du fût) : les accents se
brisaient parfois lors du serrage dans la forme (au XVIIIe
siècle, l’accent fut parfois gravé sur le côté :
« E´ »). On conçoit que certains imprimeurs aient tenté
d’en raréfier l’usage. Cet argument, le seul à bénéficier d’un
semblant de motivation, est évidemment caduc aujourd’hui.
Attention !… S’il est erroné de prétendre que la
non-accentuation des capitales est une licence typographique
accordée de longue date, il serait téméraire d’affirmer que
l’accentuation de toutes les voyelles capitales est une
très ancienne tradition… Les accents n’ont pas eu des naissances
concomitantes et, selon les voyelles qu’ils modifiaient, ils
s’imposèrent plus ou moins lentement. Les « A, I, O, U »
furent rarement accentués par les graveurs de caractères — ces
« accents » n’existaient pas dans les fontes de labeur
—, mais les « É, È, Ê » furent toujours respectés. Les
capitales accentuées comptaient parmi les lettres les plus
délicates à fondre, les plus chères et les plus fragiles de la
casse romaine, car l’étroitesse du talus supérieur imposait un
crénage (partie de l’œil qui déborde du fût) : les accents se
brisaient parfois lors du serrage dans la forme (au XVIIIe
siècle, l’accent fut parfois gravé sur le côté :
« E´ »). On conçoit que certains imprimeurs aient tenté
d’en raréfier l’usage. Cet argument, le seul à bénéficier d’un
semblant de motivation, est évidemment caduc aujourd’hui.
![]() Mots
souvent maltraités :
Mots
souvent maltraités :
![]() À
(la claire fontaine, la recherche du temps perdu, demain, bientôt,
etc.).
À
(la claire fontaine, la recherche du temps perdu, demain, bientôt,
etc.).
![]() Âmes.
Âmes.
![]() Écosse,
Éden, Édom, Égypte, Élam, Épire, Équateur, Érié, Érythrée,
États-Unis, Éthiopie, Étolie, Étrurie.
Écosse,
Éden, Édom, Égypte, Élam, Épire, Équateur, Érié, Érythrée,
États-Unis, Éthiopie, Étolie, Étrurie.
![]() Étcouen,
Élée, Éleusis, Épernay, Éphèse, Épidaure, Épinal, Étampes,
Étaples, Étretat, Évian-les-Bains, Évreux, Évry.
Étcouen,
Élée, Éleusis, Épernay, Éphèse, Épidaure, Épinal, Étampes,
Étaples, Étretat, Évian-les-Bains, Évreux, Évry.
![]() Éboué,
Écho, Édith, Édouard, Égérie, Électre, Éléonore, Éliane, Élie,
Élisabeth, Élisée, Éloi, Émile, Émilie, Éole, Éon, Épictète,
Épicure, Érasme, Érato, Ésope, Étiemble, Étienne.
Éboué,
Écho, Édith, Édouard, Égérie, Électre, Éléonore, Éliane, Élie,
Élisabeth, Élisée, Éloi, Émile, Émilie, Éole, Éon, Épictète,
Épicure, Érasme, Érato, Ésope, Étiemble, Étienne.
![]() Église,
État, Épîtres, Établissement, Éthique, Étrusques, Évangiles,
Évêché.
Église,
État, Épîtres, Établissement, Éthique, Étrusques, Évangiles,
Évêché.
![]() Èbre,
Ève, Èz
Èbre,
Ève, Èz
![]() Être.
Être.
![]() Île,
Île-de-France, Île-d’Yeu (commune).
Île,
Île-de-France, Île-d’Yeu (commune).
![]() Les
abréviations et les sigles ne devraient pas échapper à
l’accentuation des majuscules : N. D. É. (note de
l’éditeur), A.-É.F. (Afrique-Équatoriale française), É.D.F.
(Électricité de France). Leur non-accentuation est hélas l’usage
dominant (voir : Abréviation,
Sigle).
Les
abréviations et les sigles ne devraient pas échapper à
l’accentuation des majuscules : N. D. É. (note de
l’éditeur), A.-É.F. (Afrique-Équatoriale française), É.D.F.
(Électricité de France). Leur non-accentuation est hélas l’usage
dominant (voir : Abréviation,
Sigle).
![]() Les
symboles et les codes normalisés sont en revanche soumis à des
règles particulières qui, dans certains cas, les privent même des
accents sur les minuscules… : Ne pour « néon ».
Voir Chimie,
Unité
de mesure.
Les
symboles et les codes normalisés sont en revanche soumis à des
règles particulières qui, dans certains cas, les privent même des
accents sur les minuscules… : Ne pour « néon ».
Voir Chimie,
Unité
de mesure.
2. ••• Accents sur les minuscules
![]() Pour
les noms communs, voir les dictionnaires et les grammaires de la
langue française : pour les noms propres, voir les
dictionnaires encyclopédiques, les atlas, etc.
Pour
les noms communs, voir les dictionnaires et les grammaires de la
langue française : pour les noms propres, voir les
dictionnaires encyclopédiques, les atlas, etc.
![]() Relevons
simplement quelques pièges classiques :
Relevons
simplement quelques pièges classiques :
|
bailler
:
|
donner ; vous me la baillez belle. |
|
bâiller
:
|
« “On ne s’ennuie pas dans votre société”, dit Ragotte en bâillant tout grand. » – Jules RENARD, Journal |
|
bailleur
:
|
le locataire du second a tué son bailleur. |
|
bâilleur
:
|
un bon bâilleur en fait bâiller dix. |
|
bohème
:
|
jadis, autour de Montparnasse, patrie des bohèmes (les bohémiens, eux, sont plutôt nomades). |
|
Bohême :
|
autour de Prague, peuplée de Bohémiens ou, mieux, aujourd’hui, de Tchèques. |
|
ça :
|
pronom démonstratif. Il ne manquait plus que ça ! |
|
çà :
|
adverbe de lieu : ses chaussettes gisent çà et là. |
|
cote :
|
les tirailleurs ont atteint la cote 240 ; la cote de ses actions chute. |
|
côte :
|
la côte de bœuf est inabordable ; la Côte également. |
|
crête :
|
au sommet de la côte (et du coq), il y a une crête. |
|
Crète :
|
la Crète est peuplée de Crétois. |
|
cru :
|
le bouilleur de cru ne m’a pas cru, grand cru, poireau cru. |
|
crû :
|
le chiendent a crû dans ma rue. |
|
genet :
|
petit cheval, originaire d’Espagne ; Jean Genet : écrivain français. |
|
genêt :
|
arbrisseau à fleurs jaunes : cette année, les genêts fleurissent tôt. |
|
sur :
|
ce fruit est sur, cette poire est sure ; il est sur l’île. |
|
sûr :
|
ce fruit est pourri, c’est sûr ; elle est sûre d’elle. |
3.
Accents, tréma, cédille, ligatures
![]() 3.1.
Signes auxiliaires français.
3.1.
Signes auxiliaires français.

![]() ¶
Une police qui n’offre pas tous ces caractères (bas de
casse et capitales) ne doit pas être employée pour composer un
texte en français (sauf s’il s’agit d’un audacieux lipogramme).
¶
Une police qui n’offre pas tous ces caractères (bas de
casse et capitales) ne doit pas être employée pour composer un
texte en français (sauf s’il s’agit d’un audacieux lipogramme).
![]() « ÿ »
a un statut spécial… Il n’appartient plus au
« répertoire » français ; il figure néanmoins dans
la graphie de quelques noms propres : L’Haÿ-les-Roses,
Georges Demenÿ, Pierre Lecomte du Nouÿ (que depuis des décennies Larousse
et ses suiveurs transforment en [Noüy]), Pierre Louÿs (pseudonyme
de Pierre Louis), etc. Son absence n’est pas blâmable… sa présence
est néanmoins très souhaitable.
« ÿ »
a un statut spécial… Il n’appartient plus au
« répertoire » français ; il figure néanmoins dans
la graphie de quelques noms propres : L’Haÿ-les-Roses,
Georges Demenÿ, Pierre Lecomte du Nouÿ (que depuis des décennies Larousse
et ses suiveurs transforment en [Noüy]), Pierre Louÿs (pseudonyme
de Pierre Louis), etc. Son absence n’est pas blâmable… sa présence
est néanmoins très souhaitable.
![]() 3.2.
Signes auxiliaires étrangers.
3.2.
Signes auxiliaires étrangers.
![]() •
Signes réservés aux ouvrages spécialisés ; leur emploi est
déconseillé *
dans la composition des textes courants rédigés en
français :
•
Signes réservés aux ouvrages spécialisés ; leur emploi est
déconseillé *
dans la composition des textes courants rédigés en
français :
![]()
![]() Exemples.
— Anders Jonas Ångström > Angström (ou Angstrœm), Ørsted >
Œrsted.
Exemples.
— Anders Jonas Ångström > Angström (ou Angstrœm), Ørsted >
Œrsted.
![]() *
Déconseillé, car difficile et dangereux. Si l’on compose Ørsted,
on indique au lecteur que les particularités des divers alphabets
latins sont respectées. On n’a pas le droit d’ensuite le décevoir
ou, pis, de le tromper en composant :
*
Déconseillé, car difficile et dangereux. Si l’on compose Ørsted,
on indique au lecteur que les particularités des divers alphabets
latins sont respectées. On n’a pas le droit d’ensuite le décevoir
ou, pis, de le tromper en composant : ![]() .
On peut
objecter que bien mince est la différence entre les signes dont
l’emploi est recommandé dans les textes courants (Á, Ú, Ò, Ö, IJ,
Ñ, etc.) et les réprouvés, cantonnés chez les spécialistes (Å, Ø,
etc.)… et que l’argument avancé peut s’appliquer aux deux
catégories. Il me semble cependant que les accents aigu et grave,
que le tréma, présents en français sur d’autres voyelles, que la
ligature IJ et le tilde (admis depuis fort longtemps dans nos
dictionnaires) s’intègrent si naturellement au sein d’une
composition française qu’ils n’indiquent en rien que tous les
caractères spéciaux de toutes les langues usant de l’alphabet
latin y seront nécessairement reproduits.
.
On peut
objecter que bien mince est la différence entre les signes dont
l’emploi est recommandé dans les textes courants (Á, Ú, Ò, Ö, IJ,
Ñ, etc.) et les réprouvés, cantonnés chez les spécialistes (Å, Ø,
etc.)… et que l’argument avancé peut s’appliquer aux deux
catégories. Il me semble cependant que les accents aigu et grave,
que le tréma, présents en français sur d’autres voyelles, que la
ligature IJ et le tilde (admis depuis fort longtemps dans nos
dictionnaires) s’intègrent si naturellement au sein d’une
composition française qu’ils n’indiquent en rien que tous les
caractères spéciaux de toutes les langues usant de l’alphabet
latin y seront nécessairement reproduits.
![]() •/••
Signes dont l’emploi est recommandé, mais dont l’absence ne peut
et ne doit pas être considérée comme fautive dans les
•• textes rédigés en français :
•/••
Signes dont l’emploi est recommandé, mais dont l’absence ne peut
et ne doit pas être considérée comme fautive dans les
•• textes rédigés en français :
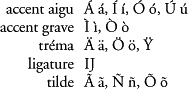
![]() Exemples.
— Les Länder allemands, l’IJ, l’IJsselmeer, Franz Lehár, cañon
(canyon), Marañón.
Exemples.
— Les Länder allemands, l’IJ, l’IJsselmeer, Franz Lehár, cañon
(canyon), Marañón.
![]() Si
certains signes sont indisponibles, reste le recours à la
tradition : Ä ä, Ö ö > Æ æ, Œ œ. Pour ceux qui récusent
tout signe étranger, restent les irréprochables graphies
francisées : Lehar, Maranon.
Si
certains signes sont indisponibles, reste le recours à la
tradition : Ä ä, Ö ö > Æ æ, Œ œ. Pour ceux qui récusent
tout signe étranger, restent les irréprochables graphies
francisées : Lehar, Maranon.
![]() ¶
Les polices courantes permettent d’obtenir tous les caractères
spéciaux de quelques langues utilisant les caractères
latins :
¶
Les polices courantes permettent d’obtenir tous les caractères
spéciaux de quelques langues utilisant les caractères
latins :

![]() En
revanche, des polices spéciales sont nécessaires pour obtenir
aisément tous les caractères des langues suivantes :
En
revanche, des polices spéciales sont nécessaires pour obtenir
aisément tous les caractères des langues suivantes :
Police courante

Police spéciale
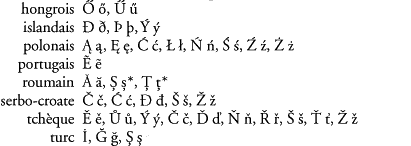
![]() *
Avec une «virgule» souscrite, et non une cédille…
*
Avec une «virgule» souscrite, et non une cédille…
![]() 3.3.
• Signes auxiliaires monstrueux (qu’il ne faut pas
confondre avec des formes similaires appartenant à certaines
langues) ; leur emploi est à proscrire dans tous les textes
composés en français qui ne sont consacrés ni à la phonétique ni à
la prosodie :
3.3.
• Signes auxiliaires monstrueux (qu’il ne faut pas
confondre avec des formes similaires appartenant à certaines
langues) ; leur emploi est à proscrire dans tous les textes
composés en français qui ne sont consacrés ni à la phonétique ni à
la prosodie :
![]()
![]() Voir :
Transcription,
translittération.
Voir :
Transcription,
translittération.
![]() Exemple.
— {
Exemple.
— {![]() ‘} :
il n’est pas nécessaire de savoir écrire l’arabe pour être
persuadé que les Arabes n’écrivent pas ainsi le nom du père de
Mahomet. Alors, pourquoi nous ? Pour transcrire la
prononciation, l’accentuation ?
‘} :
il n’est pas nécessaire de savoir écrire l’arabe pour être
persuadé que les Arabes n’écrivent pas ainsi le nom du père de
Mahomet. Alors, pourquoi nous ? Pour transcrire la
prononciation, l’accentuation ?
![]() Exemple.
— {
Exemple.
— {![]() } :
pour combiner les charmes de notre alphabet et ceux de l’alphabet
phonétique ? [purkwa pa] ? Mais c’est se donner bien du
mal pour des gens qui depuis des siècles prononcent London Londres
(ville peuplée de Londoniens) et Praha Prague (ville
peuplée de Pragois ou de Praguois).
} :
pour combiner les charmes de notre alphabet et ceux de l’alphabet
phonétique ? [purkwa pa] ? Mais c’est se donner bien du
mal pour des gens qui depuis des siècles prononcent London Londres
(ville peuplée de Londoniens) et Praha Prague (ville
peuplée de Pragois ou de Praguois).
I.
Le français a-t-il besoin d’accents ?
À
France-Langue, du 25 mars au 9 juillet 1997.
![]() O.
BETTENS :
L’« autre » en question, faut-il le rappeler, écrivait
un français quasiment sans accent, ce qui ne l’empêchait pas
d’être savoureux. Comparée à celle de Rabelais, la prose que
nous écrivons aujourd’hui, en dépit des nombreux accents qui
l’émaillent, est hautement insipide. Tout cela pour dire que le
français, en tant que langue écrite, s’est constitué sans accent
et a fonctionné sans accent (ou presque) durant les deux tiers
de son existence.
O.
BETTENS :
L’« autre » en question, faut-il le rappeler, écrivait
un français quasiment sans accent, ce qui ne l’empêchait pas
d’être savoureux. Comparée à celle de Rabelais, la prose que
nous écrivons aujourd’hui, en dépit des nombreux accents qui
l’émaillent, est hautement insipide. Tout cela pour dire que le
français, en tant que langue écrite, s’est constitué sans accent
et a fonctionné sans accent (ou presque) durant les deux tiers
de son existence.
![]() Je
ne discuterai pas vos goûts, bien que sur ce point ils soient fort
éloignés des miens. On a bien le droit de ne pas aimer les
accents.
Je
ne discuterai pas vos goûts, bien que sur ce point ils soient fort
éloignés des miens. On a bien le droit de ne pas aimer les
accents.
![]() Pour
illustrer une description personnelle de l’évolution de notre
orthographe, je ne suis toutefois pas persuadé que l’on puisse
appeler si aisément Rabelais à la rescousse.
Pour
illustrer une description personnelle de l’évolution de notre
orthographe, je ne suis toutefois pas persuadé que l’on puisse
appeler si aisément Rabelais à la rescousse.
![]() À
ce genre de sollicitation, voici ce que répond une spécialiste
(Nina Catach, les Délires de l’orthographe) de l’histoire
de l’orthographe française : « En attendant, s’il vous
plaît, ne jugez pas l’orthographe de la Renaissance d’après celle
de notre bon maître Rabelais. Il ne s’agissait que de l’une de ces
farces dont il a le secret. »
À
ce genre de sollicitation, voici ce que répond une spécialiste
(Nina Catach, les Délires de l’orthographe) de l’histoire
de l’orthographe française : « En attendant, s’il vous
plaît, ne jugez pas l’orthographe de la Renaissance d’après celle
de notre bon maître Rabelais. Il ne s’agissait que de l’une de ces
farces dont il a le secret. »
![]() La
prose hautement savoureuse de Rabelais est truffée d’archaïsmes
graphiques (pour son temps…) auprès desquels les malheureux
accents qui vous consternent ne sont que facéties discrètes.
La
prose hautement savoureuse de Rabelais est truffée d’archaïsmes
graphiques (pour son temps…) auprès desquels les malheureux
accents qui vous consternent ne sont que facéties discrètes.
![]() O.
BETTENS :
Même si je n’éprouve pas pour eux un amour immodéré, je ne peux
pas dire que je n’aime pas les accents. En tous les cas, je les
utilise comme tout francophone normalement scolarisé et je ne
milite nullement pour leur suppression… Mais j’éprouve une
certaine mauvaise humeur lorsque j’en trouve là où il n’y en
avait pas (ou peu) à l’origine, c’est-à-dire dans les éditions
de textes du Moyen Âge, de la Renaissance et aussi dans les
grands textes classiques.
O.
BETTENS :
Même si je n’éprouve pas pour eux un amour immodéré, je ne peux
pas dire que je n’aime pas les accents. En tous les cas, je les
utilise comme tout francophone normalement scolarisé et je ne
milite nullement pour leur suppression… Mais j’éprouve une
certaine mauvaise humeur lorsque j’en trouve là où il n’y en
avait pas (ou peu) à l’origine, c’est-à-dire dans les éditions
de textes du Moyen Âge, de la Renaissance et aussi dans les
grands textes classiques.
![]() Je
vous comprends… mais il existe des éditions adaptées à tous les
publics (des écoliers aux médiévistes ou aux seizièmistes, aux
dix-septièmistes…). Je ne suis pas enseignant, mais j’ai toutefois
le sentiment qu’il ne serait guère pédagogique d’imposer aux
élèves la lecture de Rabelais, de Montaigne, de Ronsard, ou même
de Molière, ou même de Voltaire dans des graphies d’époque.
Je
vous comprends… mais il existe des éditions adaptées à tous les
publics (des écoliers aux médiévistes ou aux seizièmistes, aux
dix-septièmistes…). Je ne suis pas enseignant, mais j’ai toutefois
le sentiment qu’il ne serait guère pédagogique d’imposer aux
élèves la lecture de Rabelais, de Montaigne, de Ronsard, ou même
de Molière, ou même de Voltaire dans des graphies d’époque.
![]() O.
BETTENS :
Quant à la graphie de Rabelais, qui est surtout celle de ses
imprimeurs, elle est parfaitement représentative de
l’orthographe traditionnelle de la Renaissance, c’est-à-dire non
encore influencée par les divers courants réformistes qui
marquent la seconde moitié du XVIe
siècle. En cela, elle est magnifique, n’en déplaise à Mme Catach,
dont les travaux sont par ailleurs remarquables.
O.
BETTENS :
Quant à la graphie de Rabelais, qui est surtout celle de ses
imprimeurs, elle est parfaitement représentative de
l’orthographe traditionnelle de la Renaissance, c’est-à-dire non
encore influencée par les divers courants réformistes qui
marquent la seconde moitié du XVIe
siècle. En cela, elle est magnifique, n’en déplaise à Mme Catach,
dont les travaux sont par ailleurs remarquables.
![]() Alors
là, je ne vous suis plus du tout…
Alors
là, je ne vous suis plus du tout…
![]() —
Dans un précédent message vous mettiez en avant le génie de
Rabelais et la saveur de sa graphie, et aujourd’hui vous affirmez
que cette graphie est surtout celle de ses imprimeurs. Difficile
de discuter vos arguments, s’ils changent d’une semaine à l’autre…
—
Dans un précédent message vous mettiez en avant le génie de
Rabelais et la saveur de sa graphie, et aujourd’hui vous affirmez
que cette graphie est surtout celle de ses imprimeurs. Difficile
de discuter vos arguments, s’ils changent d’une semaine à l’autre…
![]() —
D’autant que les plaisantins qui ont introduit les accents dans le
français écrit sont les imprimeurs de la Renaissance. L’accent
aigu dès 1530, avec Robert Estienne.
—
D’autant que les plaisantins qui ont introduit les accents dans le
français écrit sont les imprimeurs de la Renaissance. L’accent
aigu dès 1530, avec Robert Estienne.
![]() —
Pourquoi voulez-vous que votre apologie de l’orthographe de la
Renaissance déplaise à Mme Catach, puisque vous
dites exactement la même chose qu’elle ? Je vous rappelle que
sa phrase citée se contentait de réfuter les sollicitations
abusives de Rabelais… Par parenthèse, les travaux historiques de
Nina Catach sont certes remarquables, mais je suis loin de
partager tous ses points de vue sur la situation actuelle et
singulièrement pas, puisque c’est le sujet, son curieux penchant
pour l’accent plat (qui pourrait remplacer l’aigu et le grave).
—
Pourquoi voulez-vous que votre apologie de l’orthographe de la
Renaissance déplaise à Mme Catach, puisque vous
dites exactement la même chose qu’elle ? Je vous rappelle que
sa phrase citée se contentait de réfuter les sollicitations
abusives de Rabelais… Par parenthèse, les travaux historiques de
Nina Catach sont certes remarquables, mais je suis loin de
partager tous ses points de vue sur la situation actuelle et
singulièrement pas, puisque c’est le sujet, son curieux penchant
pour l’accent plat (qui pourrait remplacer l’aigu et le grave).
![]() O.
BETTENS :
Heureux temps en vérité que cette Renaissance où une graphie
pouvait être archaïsante ou novatrice, traditionnelle ou
réformiste, étymologisante ou phonétisante, administrative ou
littéraire, négligée ou soignée, et pas seulement (et
tristement) correcte ou incorrecte, comme c’est le cas
aujourd’hui…
O.
BETTENS :
Heureux temps en vérité que cette Renaissance où une graphie
pouvait être archaïsante ou novatrice, traditionnelle ou
réformiste, étymologisante ou phonétisante, administrative ou
littéraire, négligée ou soignée, et pas seulement (et
tristement) correcte ou incorrecte, comme c’est le cas
aujourd’hui…
![]() Heureux
temps en vérité que cette Renaissance où l’on passe du livre
manuscrit au livre imprimé, et où, par conséquent, ceux qui
imposent l’usage graphique ne sont plus tout à fait les mêmes…
Navré, mais j’ai un faible pour les imprimeurs-typographes de la
Renaissance… et pour leurs accents.
Heureux
temps en vérité que cette Renaissance où l’on passe du livre
manuscrit au livre imprimé, et où, par conséquent, ceux qui
imposent l’usage graphique ne sont plus tout à fait les mêmes…
Navré, mais j’ai un faible pour les imprimeurs-typographes de la
Renaissance… et pour leurs accents.
![]() O.
BETTENS :
De même que certains cuisiniers sans génie recouvrent
indistinctement leurs plats de béchamel, ce qui a pour effet
d’ajouter à bon compte un certain nombre de calories, mais
supprime toute surprise gustative, de même nous utilisons, avec
une efficacité indéniable, mais avec une terne monotonie, une
orthographe lisse et insipide.
O.
BETTENS :
De même que certains cuisiniers sans génie recouvrent
indistinctement leurs plats de béchamel, ce qui a pour effet
d’ajouter à bon compte un certain nombre de calories, mais
supprime toute surprise gustative, de même nous utilisons, avec
une efficacité indéniable, mais avec une terne monotonie, une
orthographe lisse et insipide.
![]() Si
je vous lis bien, depuis que l’Académie a corseté notre
orthographe, notre langue écrite est recouverte de béchamel ?
La prose lumineuse ou fulgurante de quelques écrivains, à
l’orthographe lisse et insipide, me semble avoir été confectionnée
en suivant une recette différente. Par ailleurs, si Queneau est
dans la béchamel, il fait des grumeaux. Mais c’est un autre débat…
[…]
Si
je vous lis bien, depuis que l’Académie a corseté notre
orthographe, notre langue écrite est recouverte de béchamel ?
La prose lumineuse ou fulgurante de quelques écrivains, à
l’orthographe lisse et insipide, me semble avoir été confectionnée
en suivant une recette différente. Par ailleurs, si Queneau est
dans la béchamel, il fait des grumeaux. Mais c’est un autre débat…
[…]
![]() Au
risque de me faire de nouveaux amis, je crois qu’écrire en
éliminant systématiquement l’accentuation n’est aisé que pour ceux
qui écrivent rarement à l’aide d’un clavier. Ceux qui tous les
jours pianotent pendant des heures ont de tels automatismes que
l’on voit mal pourquoi ils se donneraient une peine considérable
pour défigurer leur orthographe… Écrire moins vite chaque phrase
dans le seul dessein d’être compris par des correspondants qui
n’auraient qu’à consacrer quelques secondes pour régler leur
logiciel me semble une curieuse idée. En outre, il y a un
risque : acquérir de nouveaux automatismes qui engendreront
des fautes dans des circonstances où elles ne sont pas
souhaitables.
Au
risque de me faire de nouveaux amis, je crois qu’écrire en
éliminant systématiquement l’accentuation n’est aisé que pour ceux
qui écrivent rarement à l’aide d’un clavier. Ceux qui tous les
jours pianotent pendant des heures ont de tels automatismes que
l’on voit mal pourquoi ils se donneraient une peine considérable
pour défigurer leur orthographe… Écrire moins vite chaque phrase
dans le seul dessein d’être compris par des correspondants qui
n’auraient qu’à consacrer quelques secondes pour régler leur
logiciel me semble une curieuse idée. En outre, il y a un
risque : acquérir de nouveaux automatismes qui engendreront
des fautes dans des circonstances où elles ne sont pas
souhaitables.
![]() O.
BETTENS :
Si l’on veut aller plus loin, il faut faire intervenir les
statistiques… Je pense qu’il ne serait guère difficile de
montrer, en utilisant des textes d’une certaine longueur
(quelques pages) pris au hasard, qu’après suppression aléatoire
de 20 % des lettres, la proportion des mots et des phrases qui
resteraient compréhensibles serait très importante (nettement
supérieure à 80 %).
O.
BETTENS :
Si l’on veut aller plus loin, il faut faire intervenir les
statistiques… Je pense qu’il ne serait guère difficile de
montrer, en utilisant des textes d’une certaine longueur
(quelques pages) pris au hasard, qu’après suppression aléatoire
de 20 % des lettres, la proportion des mots et des phrases qui
resteraient compréhensibles serait très importante (nettement
supérieure à 80 %).
![]() On
peut même s’amuser à déterminer des seuils, des limites, faire
intervenir divers paramètres (nature du texte, niveau culturel du
cobaye, etc.). Je ne conteste pas l’intérêt de ces expériences
dans les laboratoires, du moment qu’elles y restent. Les
transformer en pourvoyeuses d’alibis… c’est une autre affaire.
On
peut même s’amuser à déterminer des seuils, des limites, faire
intervenir divers paramètres (nature du texte, niveau culturel du
cobaye, etc.). Je ne conteste pas l’intérêt de ces expériences
dans les laboratoires, du moment qu’elles y restent. Les
transformer en pourvoyeuses d’alibis… c’est une autre affaire.
![]() Quant
à la proportion « des mots et des phrases compréhensibles
sans grande hésitation » en l’absence d’accents, admettons,
pour vous faire plaisir, qu’elle soit de 99,9 % (pour des textes,
je le suppose, qui avec leurs accents offriraient 100 % de mots et
de phrases compréhensibles sans grande hésitation). Ce millième
incompréhensible ou simplement ambigu me fait beaucoup de peine.
D’autant qu’il est peut-être décisif. Vous tirez argument de cet
hypothétique 99,9 % pour conclure que « le débat sur les
accents et les réseaux n’est pas gouverné par des impératifs de
communication mais se situe sur le terrain de l’affectif ».
Qu’il y ait là de l’affectivité, c’est certain, mais pourquoi
exclure les « impératifs de communication » ? L’un
d’eux n’est-il pas l’élimination de toutes les erreurs
(évitables) ? S’agissant de la simple transmission physique
de l’information, si vous aviez à choisir entre une technique qui
s’acquitte de sa tâche sans erreur et une autre qui introduit
nécessairement 99,9 % d’erreurs, que feriez-vous, où irait votre
préférence ? En tant qu’épistémologue, diriez-vous que les
partisans de la première sont des puristes réactionnaires et que
les partisans de la seconde sont des esprits ouverts, de fins
réformateurs ?
Quant
à la proportion « des mots et des phrases compréhensibles
sans grande hésitation » en l’absence d’accents, admettons,
pour vous faire plaisir, qu’elle soit de 99,9 % (pour des textes,
je le suppose, qui avec leurs accents offriraient 100 % de mots et
de phrases compréhensibles sans grande hésitation). Ce millième
incompréhensible ou simplement ambigu me fait beaucoup de peine.
D’autant qu’il est peut-être décisif. Vous tirez argument de cet
hypothétique 99,9 % pour conclure que « le débat sur les
accents et les réseaux n’est pas gouverné par des impératifs de
communication mais se situe sur le terrain de l’affectif ».
Qu’il y ait là de l’affectivité, c’est certain, mais pourquoi
exclure les « impératifs de communication » ? L’un
d’eux n’est-il pas l’élimination de toutes les erreurs
(évitables) ? S’agissant de la simple transmission physique
de l’information, si vous aviez à choisir entre une technique qui
s’acquitte de sa tâche sans erreur et une autre qui introduit
nécessairement 99,9 % d’erreurs, que feriez-vous, où irait votre
préférence ? En tant qu’épistémologue, diriez-vous que les
partisans de la première sont des puristes réactionnaires et que
les partisans de la seconde sont des esprits ouverts, de fins
réformateurs ?
![]() ALB :
Les moines aiment beaucoup les jeunes.
ALB :
Les moines aiment beaucoup les jeunes.
![]() Beau
modele, ce jeune ! Beau modelé, ce jeune ! Beau modèle,
ce jeûne ! Ne me dites pas que ces moines sans accent se
rapprochent dangereusement des colons. Difficile dans ces
conditions d’accepter que l’accentuation soit un problème qui ne
concerne que les mouches.
Beau
modele, ce jeune ! Beau modelé, ce jeune ! Beau modèle,
ce jeûne ! Ne me dites pas que ces moines sans accent se
rapprochent dangereusement des colons. Difficile dans ces
conditions d’accepter que l’accentuation soit un problème qui ne
concerne que les mouches.
![]() K.
MUKUND :
Autre chose : pourquoi courriel, au fait ?
Puisqu’il s’agit de courrier électronique, ne devrait-on pas
écrire courriél, à moins de tout transcrire en lettres
capitales ? Pourquoi l’accent aigu de électronique
tomberait-il ?
K.
MUKUND :
Autre chose : pourquoi courriel, au fait ?
Puisqu’il s’agit de courrier électronique, ne devrait-on pas
écrire courriél, à moins de tout transcrire en lettres
capitales ? Pourquoi l’accent aigu de électronique
tomberait-il ?
![]() L’accent
tombe parce qu’il est inutile, ce qui est la meilleure des
raisons. En outre, dans une telle position, il serait fautif, mais
c’est peut-être secondaire… Écrivez-vous Minitél ?
L’accent
tombe parce qu’il est inutile, ce qui est la meilleure des
raisons. En outre, dans une telle position, il serait fautif, mais
c’est peut-être secondaire… Écrivez-vous Minitél ?
![]() En
outre de l’outre, même s’il n’était pas fautif, il faudrait quand
même le faire tomber, car « courriel » est un
mot-valise. Certes, il associe courrier et électronique,
mais il est subtil de faire comme si le e était commun aux
deux composants : courrier et electronique. L’accent
n’apporterait pas grand-chose à la perception
d’« électronique » mais gênerait celle de
« courrier ». Ben ça alors… Voilà que je me mets à
défendre courriel… Bravo, la D.G.L.F. !
En
outre de l’outre, même s’il n’était pas fautif, il faudrait quand
même le faire tomber, car « courriel » est un
mot-valise. Certes, il associe courrier et électronique,
mais il est subtil de faire comme si le e était commun aux
deux composants : courrier et electronique. L’accent
n’apporterait pas grand-chose à la perception
d’« électronique » mais gênerait celle de
« courrier ». Ben ça alors… Voilà que je me mets à
défendre courriel… Bravo, la D.G.L.F. !
II. Questions d’orthographe et de langue
![]() À
Typographie, le 24 juin 1997.
À
Typographie, le 24 juin 1997.
![]() P.
CAZAUX :
Comment faites-vous pour savoir s’il faut ou non un accent sur
la capitale initiale de certains noms propres, comme Édouard,
ou Éliane ? Pour ma part, j’essaie de trouver un
nom commun qui y ressemble, et j’applique la même règle.
Exemple : édulcorer ou élision. Qu’en
pensez-vous ? Et s’il n’y a pas de correspondance ?
P.
CAZAUX :
Comment faites-vous pour savoir s’il faut ou non un accent sur
la capitale initiale de certains noms propres, comme Édouard,
ou Éliane ? Pour ma part, j’essaie de trouver un
nom commun qui y ressemble, et j’applique la même règle.
Exemple : édulcorer ou élision. Qu’en
pensez-vous ? Et s’il n’y a pas de correspondance ?
![]() Votre
méthode est très, très risquée… même si l’on se contente de
l’appliquer aux seuls noms propres français (pour les autres, les
erreurs potentielles sont innombrables).
Votre
méthode est très, très risquée… même si l’on se contente de
l’appliquer aux seuls noms propres français (pour les autres, les
erreurs potentielles sont innombrables).
![]() D’où
va-t-on tirer Ève (ève) ? D’événement ?
Et Antoine Etex ? D’été… ou de Pierre Étaix ?
[…] Impossible d’éluder l’absence de l’accent… Les analogies de ce
genre sont dangereuses bien au-delà de l’initiale, et la clémence
a souvent défiguré Clemenceau…
D’où
va-t-on tirer Ève (ève) ? D’événement ?
Et Antoine Etex ? D’été… ou de Pierre Étaix ?
[…] Impossible d’éluder l’absence de l’accent… Les analogies de ce
genre sont dangereuses bien au-delà de l’initiale, et la clémence
a souvent défiguré Clemenceau…
![]() S’il
n’y a pas de correspondance, le mieux est de rester sur la même
ligne : lorsque l’on ignore la graphie d’un nom propre, la
seule méthode fiable consiste à consulter un ou plusieurs ouvrages
de référence…
S’il
n’y a pas de correspondance, le mieux est de rester sur la même
ligne : lorsque l’on ignore la graphie d’un nom propre, la
seule méthode fiable consiste à consulter un ou plusieurs ouvrages
de référence…
![]() À
France-Langue, du 25 mai au 5 juin 1998.
À
France-Langue, du 25 mai au 5 juin 1998.
![]() H.
LANDROIT :
En ce qui concerne l’accent circonflexe : les
recommandations orthographiques de 1990 proposent de le
supprimer sur le i et sur le u, étant donné que
sur ces deux lettres il n’a plus de portée phonétique.
H.
LANDROIT :
En ce qui concerne l’accent circonflexe : les
recommandations orthographiques de 1990 proposent de le
supprimer sur le i et sur le u, étant donné que
sur ces deux lettres il n’a plus de portée phonétique.
![]() Pas
si simple… La « règle (?) simplifiée » engendre des
exceptions à la pelle… Pour être clair : elle ne
« crée » pas ces formes, qui existaient déjà, elle leur
confère l’enviable statut d’« exceptions »… L’accent
circonflexe est supprimé sur le i et sur le u…
excepté…
Pas
si simple… La « règle (?) simplifiée » engendre des
exceptions à la pelle… Pour être clair : elle ne
« crée » pas ces formes, qui existaient déjà, elle leur
confère l’enviable statut d’« exceptions »… L’accent
circonflexe est supprimé sur le i et sur le u…
excepté…
![]() Voyons
le Journal officiel (je sucre les exemples) :
« […] Excepté dans les cas suivants * : a) Dans la
conjugaison, où il marque une terminaison : Au passé simple
(première et deuxième personnes du pluriel). À l’imparfait du
subjonctif (troisième personne du singulier). Au plus-que-parfait
du subjonctif (troisième personne du singulier). b) Dans les
mots où il apporte une distinction de sens utile : dû, jeûne,
les adjectifs mûr et sûr, et le verbe croître. […] Sur ce point
comme sur les autres, aucune modification n’est apportée aux noms
propres. On garde le circonflexe aussi dans les adjectifs issus de
ces noms. »
Voyons
le Journal officiel (je sucre les exemples) :
« […] Excepté dans les cas suivants * : a) Dans la
conjugaison, où il marque une terminaison : Au passé simple
(première et deuxième personnes du pluriel). À l’imparfait du
subjonctif (troisième personne du singulier). Au plus-que-parfait
du subjonctif (troisième personne du singulier). b) Dans les
mots où il apporte une distinction de sens utile : dû, jeûne,
les adjectifs mûr et sûr, et le verbe croître. […] Sur ce point
comme sur les autres, aucune modification n’est apportée aux noms
propres. On garde le circonflexe aussi dans les adjectifs issus de
ces noms. »
![]() *
Attention aux exceptions des exceptions ! La nouvelle
« règle simplifiée » est que les formes féminines et
plurielles n’ont plus droit à l’accent (comme c’est déjà le cas
pour dû, due, dus, dues),
puisqu’elles ne peuvent être confondues avec d’autres adjectifs.
Pourquoi pas ? C’est plutôt une bonne idée. C’est vite dit… Sure,
qui respecte la nouvelle « règle générale d’élimination de
l’accent circonflexe sur u », viole la nouvelle
« exception à la règle » qui veut que l’accent soit
maintenu dans les homographies d’adjectifs… En effet, c’est
(maintenant…) à la fois le féminin de sûr et de sur
(acide)…
*
Attention aux exceptions des exceptions ! La nouvelle
« règle simplifiée » est que les formes féminines et
plurielles n’ont plus droit à l’accent (comme c’est déjà le cas
pour dû, due, dus, dues),
puisqu’elles ne peuvent être confondues avec d’autres adjectifs.
Pourquoi pas ? C’est plutôt une bonne idée. C’est vite dit… Sure,
qui respecte la nouvelle « règle générale d’élimination de
l’accent circonflexe sur u », viole la nouvelle
« exception à la règle » qui veut que l’accent soit
maintenu dans les homographies d’adjectifs… En effet, c’est
(maintenant…) à la fois le féminin de sûr et de sur
(acide)…
![]() Bref,
l’orthographe simplifiée consiste à écrire croître mais accroitre…
Bref,
l’orthographe simplifiée consiste à écrire croître mais accroitre…
![]() Question…
Dans l’orthographe rectifiée, « [il] parait… », c’est
quel verbe ?
Question…
Dans l’orthographe rectifiée, « [il] parait… », c’est
quel verbe ?
![]() Remarque.
— Tout le monde sait que l’homographie n’est pas un véritable
problème, car les cas d’ambiguïté effective sont rares. On peut
certes l’ériger en motif d’exception… mais alors… autant respecter
les principes que l’on s’est imposés lors d’une réunion
précédente…
Remarque.
— Tout le monde sait que l’homographie n’est pas un véritable
problème, car les cas d’ambiguïté effective sont rares. On peut
certes l’ériger en motif d’exception… mais alors… autant respecter
les principes que l’on s’est imposés lors d’une réunion
précédente…
![]() Comme
avec le tréma, il est éclairant de mettre en regard les
recommandations anticirconflexistes de 1990 et les dernières
éditions des dictionnaires d’usage courant.
Comme
avec le tréma, il est éclairant de mettre en regard les
recommandations anticirconflexistes de 1990 et les dernières
éditions des dictionnaires d’usage courant.
![]() Comme
le dit si bien Josette Rey-Debove : « Il faut se rendre
à l’évidence ; ce ne sont pas les qualités fonctionnelles de
la langue qui intéressent les Français, mais plutôt ce qui les
surprend et ce qui les charme sans servir à rien. »
Comme
le dit si bien Josette Rey-Debove : « Il faut se rendre
à l’évidence ; ce ne sont pas les qualités fonctionnelles de
la langue qui intéressent les Français, mais plutôt ce qui les
surprend et ce qui les charme sans servir à rien. »
![]() H.
LANDROIT :
Il faut savoir aussi (mais là je m’aventure à nouveau en terrain
miné car ce genre d’arguments est tout de suite interprété comme
une « officialisation de la faute ») que l’accent
circonflexe est le principal responsable des fautes
d’orthographe.
H.
LANDROIT :
Il faut savoir aussi (mais là je m’aventure à nouveau en terrain
miné car ce genre d’arguments est tout de suite interprété comme
une « officialisation de la faute ») que l’accent
circonflexe est le principal responsable des fautes
d’orthographe.
![]() Moi,
en tout cas, je n’interprète pas cet argument comme vous semblez
le croire… Pour une raison simple, qui vous surprendra
peut-être : je n’accorde pas une grande importance aux
« fautes » d’orthographe… […] Pardonnez-moi de retourner
une fois de plus l’argument : c’est vous (j’entends les
partisans déterminés de toutes les rectifications) qui êtes
obsédés par le « problème de la faute »…
Moi,
en tout cas, je n’interprète pas cet argument comme vous semblez
le croire… Pour une raison simple, qui vous surprendra
peut-être : je n’accorde pas une grande importance aux
« fautes » d’orthographe… […] Pardonnez-moi de retourner
une fois de plus l’argument : c’est vous (j’entends les
partisans déterminés de toutes les rectifications) qui êtes
obsédés par le « problème de la faute »…
![]() Accessoirement,
je suis payé pour éliminer ces fautes, mais, essentiellement, je
dois vérifier qu’un texte est digne d’intérêt, et quand il n’en a
guère je suis parfois chargé de le modifier pour faire accroire
qu’il en a beaucoup. C’est une évidence, veuillez me la pardonner,
mais un tissu de conneries peut dès l’origine ne receler aucune
faute d’orthographe, il demeurera toujours un tissu de
conneries ; un chef-d’œuvre manuscrit peut être farci de
fautes d’orthographe, c’est, contre l’avis de tous les débusqueurs
de fautes, un chef-d’œuvre. Il suffit de lui donner un coup de
chiffon pour qu’il rutile.
Accessoirement,
je suis payé pour éliminer ces fautes, mais, essentiellement, je
dois vérifier qu’un texte est digne d’intérêt, et quand il n’en a
guère je suis parfois chargé de le modifier pour faire accroire
qu’il en a beaucoup. C’est une évidence, veuillez me la pardonner,
mais un tissu de conneries peut dès l’origine ne receler aucune
faute d’orthographe, il demeurera toujours un tissu de
conneries ; un chef-d’œuvre manuscrit peut être farci de
fautes d’orthographe, c’est, contre l’avis de tous les débusqueurs
de fautes, un chef-d’œuvre. Il suffit de lui donner un coup de
chiffon pour qu’il rutile.
![]() Une
orthographe parfaite sur une prose parfaite, ça a de la gueule. Il
serait dommage de ternir volontairement les dorures au seul profit
des allergiques au chiffon.
Une
orthographe parfaite sur une prose parfaite, ça a de la gueule. Il
serait dommage de ternir volontairement les dorures au seul profit
des allergiques au chiffon.
![]() Les
fautes d’accentuation, singulièrement pour le circonflexe et
singulièrement dans les copies d’élèves, sont plus que vénielles,
elles comptent pour du beurre… L’idée absurde, ce n’est pas de
conserver l’accent circonflexe, c’est de considérer son absence
« fautive » comme un éventuel critère d’appréciation,
voire de sélection. À ce compte-là, et pour user de l’argument que
vous redoutiez bien qu’au fond ce soit le vôtre, tous les
contresens sur Descartes (inévitables et présents dans la plupart
des copies) devraient nous conduire à éliminer du programme ce
fauteur de troubles.
Les
fautes d’accentuation, singulièrement pour le circonflexe et
singulièrement dans les copies d’élèves, sont plus que vénielles,
elles comptent pour du beurre… L’idée absurde, ce n’est pas de
conserver l’accent circonflexe, c’est de considérer son absence
« fautive » comme un éventuel critère d’appréciation,
voire de sélection. À ce compte-là, et pour user de l’argument que
vous redoutiez bien qu’au fond ce soit le vôtre, tous les
contresens sur Descartes (inévitables et présents dans la plupart
des copies) devraient nous conduire à éliminer du programme ce
fauteur de troubles.
![]() Je
ne suis pas l’odieux réactionnaire que vous imaginez : je
suis pour l’élitisme de masse, je suis pour que le français
conserve sa grâce… afin que tous en profitent et en jouissent.
Certes, cette grâce ne réside pas dans quelques accents
circonflexes… mais un péril la menace si l’on considère que ce qui
complique l’apprentissage du français peut être
« évacué » sous ce seul prétexte.
Je
ne suis pas l’odieux réactionnaire que vous imaginez : je
suis pour l’élitisme de masse, je suis pour que le français
conserve sa grâce… afin que tous en profitent et en jouissent.
Certes, cette grâce ne réside pas dans quelques accents
circonflexes… mais un péril la menace si l’on considère que ce qui
complique l’apprentissage du français peut être
« évacué » sous ce seul prétexte.
![]() J’insiste :
nous « parlons » ici de la langue écrite… Elle n’est pas
uniquement destinée à la rédaction de textes insignifiants, de
dissertations imposées, de notes au personnel, de courriers
électroniques ou de modes d’emploi… Elle est aussi celle des
poètes de sept ans.
J’insiste :
nous « parlons » ici de la langue écrite… Elle n’est pas
uniquement destinée à la rédaction de textes insignifiants, de
dissertations imposées, de notes au personnel, de courriers
électroniques ou de modes d’emploi… Elle est aussi celle des
poètes de sept ans.
![]() H.
LANDROIT :
Si sa suppression simplifie la vie de nos potaches, nous
risquons d’entendre parler encore du fameux « nivellement
par le bas ».
H.
LANDROIT :
Si sa suppression simplifie la vie de nos potaches, nous
risquons d’entendre parler encore du fameux « nivellement
par le bas ».
![]() Pas
de ma part. Je ne crois pas que l’éventuelle suppression de
l’accent circonflexe sur quelques mots accentue, si j’ose dire, le
risque de nivellement par le bas. Si ce risque existe, il est
engendré par des suppressions beaucoup plus « lourdes »…
Pas
de ma part. Je ne crois pas que l’éventuelle suppression de
l’accent circonflexe sur quelques mots accentue, si j’ose dire, le
risque de nivellement par le bas. Si ce risque existe, il est
engendré par des suppressions beaucoup plus « lourdes »…
![]() H.
LANDROIT :
Avec ce principe, on peut aller très loin (bonhomie, le nénuphar
avec ph s’étale plus paresseusement sur l’eau qu’avec f,
un chariot est plus ramassé qu’une charrette, et
j’en passe). Le but de l’orthographe n’est pas de
« surprendre » ou de « charmer sans servir à
rien ».
H.
LANDROIT :
Avec ce principe, on peut aller très loin (bonhomie, le nénuphar
avec ph s’étale plus paresseusement sur l’eau qu’avec f,
un chariot est plus ramassé qu’une charrette, et
j’en passe). Le but de l’orthographe n’est pas de
« surprendre » ou de « charmer sans servir à
rien ».
![]() Permettez-moi
de vous faire observer que Josette Rey-Debove n’a nullement édicté
un « principe » et encore moins assigné un tel
« but » à l’orthographe… Elle a simplement observé une
caractéristique de mes compatriotes. (Pour la corriger et pour
vous faire plaisir : d’un grand nombre de mes compatriotes
s’intéressant à la langue écrite.) À part ça, je suis évidemment
pour l’alignement des charriots sur les charrettes…
et les nénufars me comblent. Pour bonhommie, je
suis plus réservé…
Permettez-moi
de vous faire observer que Josette Rey-Debove n’a nullement édicté
un « principe » et encore moins assigné un tel
« but » à l’orthographe… Elle a simplement observé une
caractéristique de mes compatriotes. (Pour la corriger et pour
vous faire plaisir : d’un grand nombre de mes compatriotes
s’intéressant à la langue écrite.) À part ça, je suis évidemment
pour l’alignement des charriots sur les charrettes…
et les nénufars me comblent. Pour bonhommie, je
suis plus réservé…
![]() H.
LANDROIT :
« Question… Dans l’orthographe rectifiée, [il] parait…,
c’est quel verbe ? » Le contexte nous renseigne tout
de suite !
H.
LANDROIT :
« Question… Dans l’orthographe rectifiée, [il] parait…,
c’est quel verbe ? » Le contexte nous renseigne tout
de suite !
![]() Beaucoup
de contexte ! Car un peu ne suffit pas : « Tous les
jours, à Paris, il parait des canards. »
Beaucoup
de contexte ! Car un peu ne suffit pas : « Tous les
jours, à Paris, il parait des canards. »
![]() Dans
un cas (mais seulement avec l’« ancienne »
orthographe…), cette phrase peut parfaitement vivre seule. Je veux
bien admettre que jouant sur deux acceptions d’un même substantif
je force un peu la note, mais… franchement, ne croyez-vous pas que
notre habituel petit accent circonflexe permettrait d’y voir clair
dans l’instant et de distinguer le présent de paraître et
l’imparfait de parer… donc, par la même occasion, de
préciser le sens de canard, donc… d’éclairer et même d’établir le
contexte ? Qu’est-ce que ça peut faire qu’un écolier oublie
l’accent de paraît dans une copie d’examen ? Quelques
années plus tard, ayant grandi et beaucoup appris, il sera bien
content de le retrouver pour lire ou écrire sans effort une phrase
comme celle que je viens de donner en exemple.
Dans
un cas (mais seulement avec l’« ancienne »
orthographe…), cette phrase peut parfaitement vivre seule. Je veux
bien admettre que jouant sur deux acceptions d’un même substantif
je force un peu la note, mais… franchement, ne croyez-vous pas que
notre habituel petit accent circonflexe permettrait d’y voir clair
dans l’instant et de distinguer le présent de paraître et
l’imparfait de parer… donc, par la même occasion, de
préciser le sens de canard, donc… d’éclairer et même d’établir le
contexte ? Qu’est-ce que ça peut faire qu’un écolier oublie
l’accent de paraît dans une copie d’examen ? Quelques
années plus tard, ayant grandi et beaucoup appris, il sera bien
content de le retrouver pour lire ou écrire sans effort une phrase
comme celle que je viens de donner en exemple.
![]() P.
ANDRIES :
Expliquez donc pourquoi vous êtes contre argüer et accroitre,
si ce n’est que vous les considérez comme des formes
orthographiques fautives ?
P.
ANDRIES :
Expliquez donc pourquoi vous êtes contre argüer et accroitre,
si ce n’est que vous les considérez comme des formes
orthographiques fautives ?
![]() Je
croyais l’avoir fait… Je suis, sur ce point précis (tréma),
totalement opposé à une « réforme » qui abroge une
« règle » (en l’occurrence une « convention
techniciste »…) extrêmement simple (le tréma toujours sur la
seconde voyelle) dans le seul dessein de faire coïncider la
graphie et la prononciation (supposée « bonne »…) de
deux ou trois mots rares… Mauvais calcul…
Je
croyais l’avoir fait… Je suis, sur ce point précis (tréma),
totalement opposé à une « réforme » qui abroge une
« règle » (en l’occurrence une « convention
techniciste »…) extrêmement simple (le tréma toujours sur la
seconde voyelle) dans le seul dessein de faire coïncider la
graphie et la prononciation (supposée « bonne »…) de
deux ou trois mots rares… Mauvais calcul…
![]() Pour
l’accent circonflexe, c’est une autre affaire, beaucoup moins
simple. Plutôt que d’élaguer à la tronçonneuse et uniquement sur
le i et le u, on pourrait s’amuser à en greffer quelques-uns sur
d’autres voyelles…
Pour
l’accent circonflexe, c’est une autre affaire, beaucoup moins
simple. Plutôt que d’élaguer à la tronçonneuse et uniquement sur
le i et le u, on pourrait s’amuser à en greffer quelques-uns sur
d’autres voyelles…
![]() Les
« zônes grâcieuses », par exemple, élimineraient
quelques « fautes », ce qui comblerait en partie les
attentes des réformateurs… (Je crois que je n’aurais pas dû écrire
ça…)
Les
« zônes grâcieuses », par exemple, élimineraient
quelques « fautes », ce qui comblerait en partie les
attentes des réformateurs… (Je crois que je n’aurais pas dû écrire
ça…)
![]() P.
ANDRIES :
Quel est le critère que vous appliquez ici ?
P.
ANDRIES :
Quel est le critère que vous appliquez ici ?
![]() Celui
de tout le monde : la norme officieuse… et tout le monde sait
où la trouver… Je n’en ai pas d’autre et je n’ai aucune compétence
ou autorité particulière pour la modifier à mon gré. Cela ne
signifie pas que je considère que tout va pour le mieux dans la
meilleure des orthographes et cela ne m’empêche surtout pas de
porter des « jugements » personnels sur elle et sur les
éventuelles rectifications que des gens pressés voudraient lui
apporter… Cela ne m’interdit pas non plus, dans ma pratique
quotidienne, de la bousculer et même de l’enfreindre quand ça me
chante…
Celui
de tout le monde : la norme officieuse… et tout le monde sait
où la trouver… Je n’en ai pas d’autre et je n’ai aucune compétence
ou autorité particulière pour la modifier à mon gré. Cela ne
signifie pas que je considère que tout va pour le mieux dans la
meilleure des orthographes et cela ne m’empêche surtout pas de
porter des « jugements » personnels sur elle et sur les
éventuelles rectifications que des gens pressés voudraient lui
apporter… Cela ne m’interdit pas non plus, dans ma pratique
quotidienne, de la bousculer et même de l’enfreindre quand ça me
chante…
![]() P.
ANDRIES :
De même pour ambigüité où est le problème ?
P.
ANDRIES :
De même pour ambigüité où est le problème ?
![]() Et
dans ambiguïté, il est où le
« problème » ?…
Et
dans ambiguïté, il est où le
« problème » ?…
![]() P.
ANDRIES :
Qu’il existe encore des aiguilles sans tréma ? Si on
changeait ça en aigüille, seriez-vous alors
d’accord ?
P.
ANDRIES :
Qu’il existe encore des aiguilles sans tréma ? Si on
changeait ça en aigüille, seriez-vous alors
d’accord ?
![]() Argh !…
Vous voulez m’achever ?… Je ne serais même pas d’accord si
vous me proposiez des aiguïlles… même
« grâcieusement »…
Argh !…
Vous voulez m’achever ?… Je ne serais même pas d’accord si
vous me proposiez des aiguïlles… même
« grâcieusement »…
![]() À
Langue-Fr., le 8 septembre 1999.
À
Langue-Fr., le 8 septembre 1999.
![]() L.
BENTZ :
Me trompè-je (depuis 1990). Me trompé-je (avant
1990, avec une prononciation è).
L.
BENTZ :
Me trompè-je (depuis 1990). Me trompé-je (avant
1990, avec une prononciation è).
![]() Français :
« Me trompé-je » (avant et après 1990).
Français :
« Me trompé-je » (avant et après 1990).
![]() Français
dit rectifié : « Me trompè-je » (depuis 1990, dans
quelques cercles étroits).
Français
dit rectifié : « Me trompè-je » (depuis 1990, dans
quelques cercles étroits).
![]() À
F.L.L.F., le 4 janvier 2000.
À
F.L.L.F., le 4 janvier 2000.
![]() R.
BUDELBERGER :
Pourquoi [tatillon est-il] le seul (?) dérivé de tâter dépourvu
de circonflexe accent ?
R.
BUDELBERGER :
Pourquoi [tatillon est-il] le seul (?) dérivé de tâter dépourvu
de circonflexe accent ?
![]() Je
l’ignore. Peut-être parce que le lien fut très tôt rompu ?
Régularisons les séries… Plutôt que de suivre les barbares
élagueurs du Cons. sup. de la française langue qui décoiffent
aveuglément nos voyelles *,
posons de délicats couvre-chefs sur tâtillon ou grâcieux…
Pas gagné d’avance… Faut du courage pour s’y risquer…
Je
l’ignore. Peut-être parce que le lien fut très tôt rompu ?
Régularisons les séries… Plutôt que de suivre les barbares
élagueurs du Cons. sup. de la française langue qui décoiffent
aveuglément nos voyelles *,
posons de délicats couvre-chefs sur tâtillon ou grâcieux…
Pas gagné d’avance… Faut du courage pour s’y risquer…
![]() Comment ?
Je mélange bêtement chapellerie et sylviculture ? Bon,
d’accord, remplacez couvre-chef par cime…
Comment ?
Je mélange bêtement chapellerie et sylviculture ? Bon,
d’accord, remplacez couvre-chef par cime…
![]() *
J’entends déjà les groupies du Cons. sup. rétorquer que les
« â » ont échappé à la tronçonneuse, que seuls les î
et les û ont dégusté… Dont acte anticipé…
*
J’entends déjà les groupies du Cons. sup. rétorquer que les
« â » ont échappé à la tronçonneuse, que seuls les î
et les û ont dégusté… Dont acte anticipé…
![]() A.
DEMERSON :
J’en pense que je me suis frotté la première fois à
l’orthographe il y a fort longtemps, que les personnes d’un
certain âge, pour ne pas dire d’un âge certain, ne changent pas
leurs habitudes, et que donc je ne mets pas de chapeau à tatillon
ni à gracieux.
A.
DEMERSON :
J’en pense que je me suis frotté la première fois à
l’orthographe il y a fort longtemps, que les personnes d’un
certain âge, pour ne pas dire d’un âge certain, ne changent pas
leurs habitudes, et que donc je ne mets pas de chapeau à tatillon
ni à gracieux.
![]() Moi
non plus (je n’en ai pas les moyens), mais je me garde bien de
justifier ma pratique par l’âge… Cette position est indéfendable…
Changez-en tant qu’il en est encore temps…
Moi
non plus (je n’en ai pas les moyens), mais je me garde bien de
justifier ma pratique par l’âge… Cette position est indéfendable…
Changez-en tant qu’il en est encore temps…
![]() À
F.L.L.F., le 19 janvier 2000.
À
F.L.L.F., le 19 janvier 2000.
![]() A.
D. : « Sur les premiers billets [de 50 F],
il était écrit Saint-Éxupéri. » Voilà qui
m’étonnerait fort.
A.
D. : « Sur les premiers billets [de 50 F],
il était écrit Saint-Éxupéri. » Voilà qui
m’étonnerait fort.
![]() C’est
pourtant vrai… Enfin… n’exagérons rien… Laissons tomber le i
qui n’a rien à voir dans cette affaire de caps accentuées…
C’est
pourtant vrai… Enfin… n’exagérons rien… Laissons tomber le i
qui n’a rien à voir dans cette affaire de caps accentuées…
![]() Les
premiers billets (j’espère que vous en avez gardé un…) étaient
affublés d’un étonnant Saint-Éxupery…
Les
premiers billets (j’espère que vous en avez gardé un…) étaient
affublés d’un étonnant Saint-Éxupery…
![]() À
F.L.L.F., le 14 février 2001.
À
F.L.L.F., le 14 février 2001.
![]() D.
DIDIER :
On enseigne trop souvent que l’accent circonflexe ne noterait
qu’un s disparu alors qu’il pouvait posséder une valeur
distincte.
D.
DIDIER :
On enseigne trop souvent que l’accent circonflexe ne noterait
qu’un s disparu alors qu’il pouvait posséder une valeur
distincte.
![]() Oui,
et pour rester dans le domaine néerlandais, notre bôme
exprime fort bien l’allongement de boom…
Oui,
et pour rester dans le domaine néerlandais, notre bôme
exprime fort bien l’allongement de boom…
![]() Encore
heureux que l’emprunt soit ancien… Aujourd’hui, compte tenu de la
négligente fascination ambiante, nos gréements acquerraient
rapidos un cachet explosif…
Encore
heureux que l’emprunt soit ancien… Aujourd’hui, compte tenu de la
négligente fascination ambiante, nos gréements acquerraient
rapidos un cachet explosif…
![]() À
F.L.L.F., le 11 mars 2001.
À
F.L.L.F., le 11 mars 2001.
![]() J.
HECKMAN :
Si le but est d’éviter les homographies, pourquoi maintenir
l’accent pour dûs ?
J.
HECKMAN :
Si le but est d’éviter les homographies, pourquoi maintenir
l’accent pour dûs ?
![]() Pour
faire une faute d’orthographe…
Pour
faire une faute d’orthographe…
![]() À
F.L.L.F., le 13 juin 2001.
À
F.L.L.F., le 13 juin 2001.
![]() DAIMONAX :
Pour finir, les Règles typographiques en usage à
l’Imprimerie nationale […] sont une « marche maison »
(comme le titre l’indique).
DAIMONAX :
Pour finir, les Règles typographiques en usage à
l’Imprimerie nationale […] sont une « marche maison »
(comme le titre l’indique).
![]() Oui,
mais c’est une marche qui présente une caractéristique qui la fait
accéder à un autre statut : elle est diffusée… Ajoutez le
poids symbolique de la maison et, surtout, la qualité du document,
vous obtenez un code… aujourd’hui considéré comme le meilleur du
genre par un nombre croissant de professionnels. Il faut dire que
cette tendance a été largement favorisée par le catastrophique
« Nouveau » Code typo de la Fédération de
la communication C.F.E./C.G.C. (successeur du Code
typographique de la FIPEC, qui fut longtemps une référence).
Oui,
mais c’est une marche qui présente une caractéristique qui la fait
accéder à un autre statut : elle est diffusée… Ajoutez le
poids symbolique de la maison et, surtout, la qualité du document,
vous obtenez un code… aujourd’hui considéré comme le meilleur du
genre par un nombre croissant de professionnels. Il faut dire que
cette tendance a été largement favorisée par le catastrophique
« Nouveau » Code typo de la Fédération de
la communication C.F.E./C.G.C. (successeur du Code
typographique de la FIPEC, qui fut longtemps une référence).
![]() Comme
vous le savez, des marches, il y en a des dizaines. Chaque grande
maison en a une, « réservée à un usage interne ». Ainsi
les Règles typographiques en usage au département
lecture-correction Larousse. Les divergences sont de moins
en moins nombreuses. Au-delà des marches maison, vous avez parfois
des protocoles particuliers, pour une collection, voire pour un
seul ouvrage. J’en ai rédigé de nombreux (c’est d’ailleurs
l’occupation de ma semaine).
Comme
vous le savez, des marches, il y en a des dizaines. Chaque grande
maison en a une, « réservée à un usage interne ». Ainsi
les Règles typographiques en usage au département
lecture-correction Larousse. Les divergences sont de moins
en moins nombreuses. Au-delà des marches maison, vous avez parfois
des protocoles particuliers, pour une collection, voire pour un
seul ouvrage. J’en ai rédigé de nombreux (c’est d’ailleurs
l’occupation de ma semaine).
![]() Les
écarts (je ne dis pas les « fautes »…) ressortiront de
moins en moins souvent à l’orthotypographie, car celle-ci est
intimement liée à la langue écrite… qui, par bonheur, n’est pas le
bien des seuls typographes (et encore moins des
graphistes-paoïstes…). L’accentuation ne peut être réduite à un
simple problème typographique, c’est un fait de langue
(« écrite », j’insiste… on ne sait jamais…). Comme vous
le soulignez, la contrainte matérielle (et l’alibi corporatiste…)
de l’interlignage n’existe plus dans ces termes. Ce n’était
d’ailleurs pas le seul paramètre technique — les ennuis causés par
le crénage (au sens ancien) latéral étaient dans certains cas
résolus par les ligatures, mais impossible d’éliminer le crénage
vertical des caps accentuées —, sans parler des raisons
linguistiques (tous les accents ne sont pas nés et ne se sont pas
imposés le même jour… même sur les minuscules) ou économiques (les
caractères crénés étaient fragiles et chers)…
Les
écarts (je ne dis pas les « fautes »…) ressortiront de
moins en moins souvent à l’orthotypographie, car celle-ci est
intimement liée à la langue écrite… qui, par bonheur, n’est pas le
bien des seuls typographes (et encore moins des
graphistes-paoïstes…). L’accentuation ne peut être réduite à un
simple problème typographique, c’est un fait de langue
(« écrite », j’insiste… on ne sait jamais…). Comme vous
le soulignez, la contrainte matérielle (et l’alibi corporatiste…)
de l’interlignage n’existe plus dans ces termes. Ce n’était
d’ailleurs pas le seul paramètre technique — les ennuis causés par
le crénage (au sens ancien) latéral étaient dans certains cas
résolus par les ligatures, mais impossible d’éliminer le crénage
vertical des caps accentuées —, sans parler des raisons
linguistiques (tous les accents ne sont pas nés et ne se sont pas
imposés le même jour… même sur les minuscules) ou économiques (les
caractères crénés étaient fragiles et chers)…
![]() J.-M.
MUNIER :
Si, par contre, vous ne mettez pas [d’accent sur les capitales]
et qu’il faille ultérieurement les rajouter, imaginez le boulot.
J.-M.
MUNIER :
Si, par contre, vous ne mettez pas [d’accent sur les capitales]
et qu’il faille ultérieurement les rajouter, imaginez le boulot.
![]() Oui,
mais ce n’est encore rien… Quand il s’agit de noms propres,
imaginez la perte d’information, parfois irrémédiable… même en
bossant…
Oui,
mais ce n’est encore rien… Quand il s’agit de noms propres,
imaginez la perte d’information, parfois irrémédiable… même en
bossant…
III.
Les points sur les i, les points sur les I
![]() À
Typographie, les 6 et 7 avril 1998.
À
Typographie, les 6 et 7 avril 1998.
![]() P.
CAZAUX :
Rétablir le point sur le I cap, ce qui n’est pas idiot, à mon
avis, bicoze y’a pas de raison qu’il n’y soit pas. D’ailleurs,
je serais curieux d’avoir la cause historique de cette absence.
Je subodore une mesquine tentative d’économie datant du plomb,
le point étant la partie fragile de la lettre en cas de chute,
mais alors pourquoi le laisser sur les b. de c. ?
P.
CAZAUX :
Rétablir le point sur le I cap, ce qui n’est pas idiot, à mon
avis, bicoze y’a pas de raison qu’il n’y soit pas. D’ailleurs,
je serais curieux d’avoir la cause historique de cette absence.
Je subodore une mesquine tentative d’économie datant du plomb,
le point étant la partie fragile de la lettre en cas de chute,
mais alors pourquoi le laisser sur les b. de c. ?
![]() Le
plomb n’est pas en cause… mais le bec fendu. On n’a éliminé aucun
point sur la majuscule, on en a attribué un à la minuscule,
histoire de la reconnaître au voisinage d’autres petits bâtons
plus ou moins liés… (ui ou iu ?).
Le
plomb n’est pas en cause… mais le bec fendu. On n’a éliminé aucun
point sur la majuscule, on en a attribué un à la minuscule,
histoire de la reconnaître au voisinage d’autres petits bâtons
plus ou moins liés… (ui ou iu ?).
![]() Bref,
le point sur le I cap est encore une (F.) riche idée…
Bref,
le point sur le I cap est encore une (F.) riche idée…
![]() P.
CAZAUX :
J’ai bien compris. Mais pourrais-tu développer ce que tu entends
par « bec fendu » ?
P.
CAZAUX :
J’ai bien compris. Mais pourrais-tu développer ce que tu entends
par « bec fendu » ?
![]() Pas
grand-chose… c’était un petit accès de préciosité… Par bec fendu,
j’entends tout instrument d’écriture dont la pointe est fendue
(afin de favoriser la capillarité), en l’occurrence le calame (au
sens strict) et, surtout, la plume de zoziau… Quel snob… Tout ça
pour dire que le point sur le i est une trouvaille des copistes…
Pas
grand-chose… c’était un petit accès de préciosité… Par bec fendu,
j’entends tout instrument d’écriture dont la pointe est fendue
(afin de favoriser la capillarité), en l’occurrence le calame (au
sens strict) et, surtout, la plume de zoziau… Quel snob… Tout ça
pour dire que le point sur le i est une trouvaille des copistes…
![]() J.
ANDRÉ :
Quand s’est transformé cet accent en point ? Nina Catach
n’en parle guère !
J.
ANDRÉ :
Quand s’est transformé cet accent en point ? Nina Catach
n’en parle guère !
![]() Accent :
XIe
siècle. Premiers points : fin du XIIe.
Victoire définitive du point : fin du XVe…
En tout cas, c’est ce qui se dit habituellement…
Accent :
XIe
siècle. Premiers points : fin du XIIe.
Victoire définitive du point : fin du XVe…
En tout cas, c’est ce qui se dit habituellement…
![]() Comme
quoi… à y regarder de plus près, il est peut-être excessif
d’affirmer comme je l’ai fait que le plomb est totalement étranger
à l’affaire… Il n’est pour rien, évidemment, dans l’apparition du
point… mais il a sans doute quelque chose à voir dans la
généralisation de son emploi…
Comme
quoi… à y regarder de plus près, il est peut-être excessif
d’affirmer comme je l’ai fait que le plomb est totalement étranger
à l’affaire… Il n’est pour rien, évidemment, dans l’apparition du
point… mais il a sans doute quelque chose à voir dans la
généralisation de son emploi…
![]() À
Typographie, le 18 juillet 2000.
À
Typographie, le 18 juillet 2000.
![]() O.
RANDIER :
Sur les majuscules, la confusion du I avec d’autres
choses est quasi impossible, il n’est donc pas nécessaire d’y
mettre un point, c’est même déconseillé.
O.
RANDIER :
Sur les majuscules, la confusion du I avec d’autres
choses est quasi impossible, il n’est donc pas nécessaire d’y
mettre un point, c’est même déconseillé.
![]() Je
suis bien entendu d’accord avec tes explications historiques et
tes recommandations typographiques… mais ton ultime argument me
fait tiquer, car… s’il est une cap qui peut être confondue dans
certaines polices avec d’autres signes (l (lettre « L »
bas de casse), 1 (chiffre un)…), c’est bien le I ! Par
conséquent, si comme moi tu ne tiens pas à voir fleurir des Í
boutonneux, ne prête pas le flanc aux contestations faciles des
sectateurs de la toute-puissante Lisibilité…
Je
suis bien entendu d’accord avec tes explications historiques et
tes recommandations typographiques… mais ton ultime argument me
fait tiquer, car… s’il est une cap qui peut être confondue dans
certaines polices avec d’autres signes (l (lettre « L »
bas de casse), 1 (chiffre un)…), c’est bien le I ! Par
conséquent, si comme moi tu ne tiens pas à voir fleurir des Í
boutonneux, ne prête pas le flanc aux contestations faciles des
sectateurs de la toute-puissante Lisibilité…
![]() Dans
la plupart des linéales, un I pointé serait certes monstrueux,
hideux, scandaleux et toutes ces sortes de choses, mais serait-il
complètement inutile ? Pas sûr, pas gagné d’avance. Re-donc,
prudence…
Dans
la plupart des linéales, un I pointé serait certes monstrueux,
hideux, scandaleux et toutes ces sortes de choses, mais serait-il
complètement inutile ? Pas sûr, pas gagné d’avance. Re-donc,
prudence…
IV.
Combien y a-t-il
de caractères accentués dans une casse ?
![]() À
Typographie, du 19 au 23 novembre 1998.
À
Typographie, du 19 au 23 novembre 1998.
![]() J.
ANDRÉ :
Un autre problème sous-jacent est : quelle est la liste
des caractères français ? Et d’ailleurs y en a-t-il
une ?
J.
ANDRÉ :
Un autre problème sous-jacent est : quelle est la liste
des caractères français ? Et d’ailleurs y en a-t-il
une ?
![]() Aucun
code typographique ne la donne (ce doit être tellement
évident…) sauf à la rigueur l’I.N. qui est incomplet.
Aucun
code typographique ne la donne (ce doit être tellement
évident…) sauf à la rigueur l’I.N. qui est incomplet.
![]() À
mon sens, le Lexique de l’I.N. est complet sur ce point…
à â é è ê ë î ï ô ù û ç æ œ. Tu me diras, où sont les ä,
ö, ÿ ? Eh bien, ils ne sont pas indispensables
à la composition du français, c’est-à-dire, très précisément, à
la composition de la langue française d’aujourd’hui. Cela ne
signifie pas que ces signes et bien d’autres (á, ã,
ñ, etc.) ne sont pas nécessaires à la composition d’un
texte rédigé en français !
À
mon sens, le Lexique de l’I.N. est complet sur ce point…
à â é è ê ë î ï ô ù û ç æ œ. Tu me diras, où sont les ä,
ö, ÿ ? Eh bien, ils ne sont pas indispensables
à la composition du français, c’est-à-dire, très précisément, à
la composition de la langue française d’aujourd’hui. Cela ne
signifie pas que ces signes et bien d’autres (á, ã,
ñ, etc.) ne sont pas nécessaires à la composition d’un
texte rédigé en français !
![]() Le
fameux ÿ n’intervient que dans des noms propres ; ä
peut toujours être remplacé par æ… (Toutefois, on a bien
raison de les employer et de tenter de les intégrer à un
pangramme, mais pas à tout prix !… Bon, pour le ä,
c’est pas encore ça… Quant au reste… oublions-le ici.)
Le
fameux ÿ n’intervient que dans des noms propres ; ä
peut toujours être remplacé par æ… (Toutefois, on a bien
raison de les employer et de tenter de les intégrer à un
pangramme, mais pas à tout prix !… Bon, pour le ä,
c’est pas encore ça… Quant au reste… oublions-le ici.)
![]() J.-P
LACROUX :
« à â é è ê ë î ï ô ù û ç æ œ ».
J.-P
LACROUX :
« à â é è ê ë î ï ô ù û ç æ œ ».
![]() Pas
malin ! j’ai oublié le ü ! à coup sûr très
utile dans la secte des Rectificateurs !
Pas
malin ! j’ai oublié le ü ! à coup sûr très
utile dans la secte des Rectificateurs !
![]() A.
LABONTÉ :
Par ailleurs, le ä et le ö de mälström
ne sont essentiels ni à l’écriture de ce mot, ni au français.
A.
LABONTÉ :
Par ailleurs, le ä et le ö de mälström
ne sont essentiels ni à l’écriture de ce mot, ni au français.
![]() Ici,
je te reçois 5/5…
Ici,
je te reçois 5/5…
![]() A.
HURTIG :
Mais de notre point de vue, les « lettres de la
langue » ne sont pas nécessairement françaises.
A.
HURTIG :
Mais de notre point de vue, les « lettres de la
langue » ne sont pas nécessairement françaises.
![]() Qu’un
typographe (au sens très large…) ait besoin de nombreux signes
« exotiques » pour composer un texte rédigé en
français, c’est évident, mais cela ne change rien au fait qu’un
nombre limité de signes alphabétiques est nécessaire à la
composition de la langue française…
Qu’un
typographe (au sens très large…) ait besoin de nombreux signes
« exotiques » pour composer un texte rédigé en
français, c’est évident, mais cela ne change rien au fait qu’un
nombre limité de signes alphabétiques est nécessaire à la
composition de la langue française…
![]() A.
HURTIG :
À ce propos, j’ai toujours été intrigué par la position des
accents circonflexes dans la ligne consacrée par l’I.N.
à l’espéranto : ils sont très hauts, sans doute pour
s’aligner avec le circonflexe sur le h. Le
problème, c’est que c’est assez laid, et que cet espace vide
entre la lettre et son diacritique n’est pas réellement
justifié. Est-ce que c’est traditionnel en espéranto ?
A.
HURTIG :
À ce propos, j’ai toujours été intrigué par la position des
accents circonflexes dans la ligne consacrée par l’I.N.
à l’espéranto : ils sont très hauts, sans doute pour
s’aligner avec le circonflexe sur le h. Le
problème, c’est que c’est assez laid, et que cet espace vide
entre la lettre et son diacritique n’est pas réellement
justifié. Est-ce que c’est traditionnel en espéranto ?
![]() Non…
Ces faux circonflexes indiquent les consonnes chuintantes. Sur
le u, j’ai bien l’impression que c’est une erreur…
Confusion avec l’accent bref… qui est pourtant bien arrondi… et
orienté à l’inverse du circonflexe…
Non…
Ces faux circonflexes indiquent les consonnes chuintantes. Sur
le u, j’ai bien l’impression que c’est une erreur…
Confusion avec l’accent bref… qui est pourtant bien arrondi… et
orienté à l’inverse du circonflexe…
![]() L’I.N.
n’a visiblement pas de police espérantiste (je la comprends…).
Elle a bricolé un machin atroce avec des chapeaux à la con qui
ne sont ni du corps ni même de la police… Elle les a situés (à
l’origine) sur l’interligne (impossible de faire autrement),
donc en ligne…
L’I.N.
n’a visiblement pas de police espérantiste (je la comprends…).
Elle a bricolé un machin atroce avec des chapeaux à la con qui
ne sont ni du corps ni même de la police… Elle les a situés (à
l’origine) sur l’interligne (impossible de faire autrement),
donc en ligne…
![]() A.
HURTIG :
Est-ce qu’il n’aurait pas mieux valu aligner tous les
circonflexes à une hauteur normale, quitte à caser au
chausse-pied celui du h à côté de la hampe ?
A.
HURTIG :
Est-ce qu’il n’aurait pas mieux valu aligner tous les
circonflexes à une hauteur normale, quitte à caser au
chausse-pied celui du h à côté de la hampe ?
![]() Et
comment tu aurais fait ça avec des caractères en plomb ?…
Deux coups de scie, quatre coups de lime (* 6) à l’aide de la
servante JiDienne ?…
Et
comment tu aurais fait ça avec des caractères en plomb ?…
Deux coups de scie, quatre coups de lime (* 6) à l’aide de la
servante JiDienne ?…
![]() Bon
[…] elle aurait pu y parvenir avec une simple paire de ciseaux…
mais vu que le monteur a déjà été incapable d’aligner
correctement quelques lignes, vaut sans doute mieux qu’elle s’en
soit abstenue…
Bon
[…] elle aurait pu y parvenir avec une simple paire de ciseaux…
mais vu que le monteur a déjà été incapable d’aligner
correctement quelques lignes, vaut sans doute mieux qu’elle s’en
soit abstenue…
![]() A.
HURTIG :
À la date d’édition (1994 pour mon exemplaire), j’aurais sorti
mon Fontographer ou mon FontStudio, et j’aurais essayé de
travailler proprement.
A.
HURTIG :
À la date d’édition (1994 pour mon exemplaire), j’aurais sorti
mon Fontographer ou mon FontStudio, et j’aurais essayé de
travailler proprement.
![]() Je
te rappelle que les polices reproduites dans ce tableau de
guingois sont des plombs ! S’agit pas de les péter… Oui,
notre bonne I.N. aurait pu vectoriser tout ça… mais elle aurait
mieux fait de montrer qu’elle savait encore ce qu’est la
composition chaude ou, plus bêtement encore, le montage au quart
de poil…
Je
te rappelle que les polices reproduites dans ce tableau de
guingois sont des plombs ! S’agit pas de les péter… Oui,
notre bonne I.N. aurait pu vectoriser tout ça… mais elle aurait
mieux fait de montrer qu’elle savait encore ce qu’est la
composition chaude ou, plus bêtement encore, le montage au quart
de poil…
V.
Capitales accentuées :
principes fondateurs
![]() À
France-Langue, le 29 mai 1997.
À
France-Langue, le 29 mai 1997.
![]() P.-O.
FINELTIN :
Je pense que des choix graphiques dans certains documents —
publicitaires par exemple — nécessitent parfois de ne pas mettre
l’accent. C’est donc, je pense, le besoin (de sens ou d’aspect)
qui guide l’accentuation.
P.-O.
FINELTIN :
Je pense que des choix graphiques dans certains documents —
publicitaires par exemple — nécessitent parfois de ne pas mettre
l’accent. C’est donc, je pense, le besoin (de sens ou d’aspect)
qui guide l’accentuation.
![]() D’accord…
mais vous êtes à la limite de l’image et du texte… Là, un peu de
souplesse ne fait pas de mal…
D’accord…
mais vous êtes à la limite de l’image et du texte… Là, un peu de
souplesse ne fait pas de mal…
![]() À
France-Langue, du 2 mars au 16 avril 1998.
À
France-Langue, du 2 mars au 16 avril 1998.
![]() B.
A. DONVEZ :
Bien que l’usage d’accentuer les majuscules se répande, quelques
irréductibles gallocentriques cherchent à y résister…
B.
A. DONVEZ :
Bien que l’usage d’accentuer les majuscules se répande, quelques
irréductibles gallocentriques cherchent à y résister…
![]() Je
ne vois pas où est le gallocentrisme chez ces irréductibles… La
proposition inverse serait beaucoup plus proche de la réalité. Les
capitales doivent être accentuées. Tous les codes l’affirment…
Cette unanimité est bien rare…
Je
ne vois pas où est le gallocentrisme chez ces irréductibles… La
proposition inverse serait beaucoup plus proche de la réalité. Les
capitales doivent être accentuées. Tous les codes l’affirment…
Cette unanimité est bien rare…
![]() P.-O.
FINELTIN :
La corporation imposa donc la norme de la majuscule non
accentuée aux correcteurs d’édition.
P.-O.
FINELTIN :
La corporation imposa donc la norme de la majuscule non
accentuée aux correcteurs d’édition.
![]() Pas
si simple… Pour le À (accent purement diacritique) et bien sûr
pour les accents (et les trémas) sur les I, O et U cap, vous avez
en partie * raison… mais certainement pas pour les divers E
accentués ! La « norme » typographique de base a toujours
été l’accentuation des E (accents grave, aigu et circonflexe)… Ils
appartenaient à la plupart des bonnes polices de labeur. Ça se
conçoit : leur absence (surtout celle du É…) peut entraîner
des difficultés de prononciation et surtout de graves erreurs
d’interprétation dans une compo en toutes caps ou en petites caps,
ce qui est rarement le cas avec les autres voyelles accentuées
(même le ù…).
Pas
si simple… Pour le À (accent purement diacritique) et bien sûr
pour les accents (et les trémas) sur les I, O et U cap, vous avez
en partie * raison… mais certainement pas pour les divers E
accentués ! La « norme » typographique de base a toujours
été l’accentuation des E (accents grave, aigu et circonflexe)… Ils
appartenaient à la plupart des bonnes polices de labeur. Ça se
conçoit : leur absence (surtout celle du É…) peut entraîner
des difficultés de prononciation et surtout de graves erreurs
d’interprétation dans une compo en toutes caps ou en petites caps,
ce qui est rarement le cas avec les autres voyelles accentuées
(même le ù…).
![]() *
En partie, car certaines polices comprenaient ces capitales et
petites capitales accentuées, indispensables dans les compositions
soignées. Il est vrai que la fragilité (crénage supérieur) des
capitales accentuées n’a guère favorisé leur emploi. Il faut
ajouter les éventuelles difficultés d’interlignage.
*
En partie, car certaines polices comprenaient ces capitales et
petites capitales accentuées, indispensables dans les compositions
soignées. Il est vrai que la fragilité (crénage supérieur) des
capitales accentuées n’a guère favorisé leur emploi. Il faut
ajouter les éventuelles difficultés d’interlignage.
![]() O.
BETTENS :
Est-ce à dire que l’« usage » typographique de base a
souvent été contraire à la « norme » ?
O.
BETTENS :
Est-ce à dire que l’« usage » typographique de base a
souvent été contraire à la « norme » ?
![]() Certes…
mais il est difficile d’apprécier ce « souvent »… À
quelle époque et, surtout, dans quel type de composition ou
d’ouvrage ? Je n’imagine pas les contours de la « norme
typographique » de telle ou telle période à partir
d’observations partielles de l’usage mais je tente de la saisir
grâce à l’étude des manuels et des codes typographiques, type
d’ouvrages dont la conception et la multiplication sont liées à
l’évolution des techniques et rédigés, souvent (donc… pas
toujours), par des gens qui connaissaient plutôt bien leur métier
et leur langue.
Certes…
mais il est difficile d’apprécier ce « souvent »… À
quelle époque et, surtout, dans quel type de composition ou
d’ouvrage ? Je n’imagine pas les contours de la « norme
typographique » de telle ou telle période à partir
d’observations partielles de l’usage mais je tente de la saisir
grâce à l’étude des manuels et des codes typographiques, type
d’ouvrages dont la conception et la multiplication sont liées à
l’évolution des techniques et rédigés, souvent (donc… pas
toujours), par des gens qui connaissaient plutôt bien leur métier
et leur langue.
![]() O.
BETTENS :
Cela est vrai pour les mots ou phrases entièrement imprimés en
capitales, pas pour les majuscules initiales, il me semble…
O.
BETTENS :
Cela est vrai pour les mots ou phrases entièrement imprimés en
capitales, pas pour les majuscules initiales, il me semble…
![]() Il
est certain que le défaut d’accentuation des capitales est surtout
gênant dans les compositions en capitales. Pour autant, il ne faut
jamais oublier que dans les compositions en bas de casse, les noms
propres ont toujours l’initiale en capitale. Leur refuser
l’accentuation est une erreur à mon sens manifeste…
Il
est certain que le défaut d’accentuation des capitales est surtout
gênant dans les compositions en capitales. Pour autant, il ne faut
jamais oublier que dans les compositions en bas de casse, les noms
propres ont toujours l’initiale en capitale. Leur refuser
l’accentuation est une erreur à mon sens manifeste…
![]() O.
BETTENS :
Lorsque j’écris, je ne mets pas d’accents sur les majuscules
initiales : à I’école, on nous comptait une demi-faute pour
une majuscule accentuée. Ce sont des choses qui marquent. Je ne
vois pas pourquoi je changerais (aucune « norme », en
tout cas, ne me fera céder)…
O.
BETTENS :
Lorsque j’écris, je ne mets pas d’accents sur les majuscules
initiales : à I’école, on nous comptait une demi-faute pour
une majuscule accentuée. Ce sont des choses qui marquent. Je ne
vois pas pourquoi je changerais (aucune « norme », en
tout cas, ne me fera céder)…
![]() S’agissant
de votre « écriture », personne (en tout cas, pas moi)
ne songe à vous imposer le respect d’une quelconque norme
« typographique »…
S’agissant
de votre « écriture », personne (en tout cas, pas moi)
ne songe à vous imposer le respect d’une quelconque norme
« typographique »…
![]() O.
BETTENS :
Je viens de jeter un coup d’œil au Guide du typographe
romand (éd. 1993, p. 37), qui est plutôt normatif, et
j’ai été surpris de lire ceci : « On ne met pas
d’accent à la lettre initiale (capitale) d’un mot en bas de
casse : Ame/Emile/Ere. […] En revanche, on met les
accents dans un mot ou une phrase entièrement en
capitales : AVÈNEMENT/DÉJÀ/ÉMILE. » On peut
bien sûr dire que ce Guide « a tort ». Il
n’empêche qu’il jouit ici d’une autorité indéniable parmi les
professionnels et qu’il est souvent la référence ultime des
« typographes amateurs » que le développement de
l’informatique a fait fleurir.
O.
BETTENS :
Je viens de jeter un coup d’œil au Guide du typographe
romand (éd. 1993, p. 37), qui est plutôt normatif, et
j’ai été surpris de lire ceci : « On ne met pas
d’accent à la lettre initiale (capitale) d’un mot en bas de
casse : Ame/Emile/Ere. […] En revanche, on met les
accents dans un mot ou une phrase entièrement en
capitales : AVÈNEMENT/DÉJÀ/ÉMILE. » On peut
bien sûr dire que ce Guide « a tort ». Il
n’empêche qu’il jouit ici d’une autorité indéniable parmi les
professionnels et qu’il est souvent la référence ultime des
« typographes amateurs » que le développement de
l’informatique a fait fleurir.
![]() En
la matière, le problème n’est pas d’avoir tort ou raison… mais de
justifier ses choix en avançant au moins une raison recevable,
quelle que soit sa nature (historique, technique, linguistique,
etc.). Or, ici, que dalle… Faut faire comme ça parce que je le
dis, point, circulez. « Pourquoi ? » est une
question aujourd’hui inconnue chez les rédacteurs de codes. On les
comprend. Or, cette différence de traitement entre « tout
cap » et « capitale initiale » mériterait quelques
explications… non ?
En
la matière, le problème n’est pas d’avoir tort ou raison… mais de
justifier ses choix en avançant au moins une raison recevable,
quelle que soit sa nature (historique, technique, linguistique,
etc.). Or, ici, que dalle… Faut faire comme ça parce que je le
dis, point, circulez. « Pourquoi ? » est une
question aujourd’hui inconnue chez les rédacteurs de codes. On les
comprend. Or, cette différence de traitement entre « tout
cap » et « capitale initiale » mériterait quelques
explications… non ?
![]() Au
petit jeu des tables de la Loi typographique immanente, d’autres
prophètes (Imprimerie nationale), dont l’autorité est
encore plus indéniable, répondent ceci : « On veillera à
utiliser systématiquement les capitales accentuées, y compris la
préposition À. »
Au
petit jeu des tables de la Loi typographique immanente, d’autres
prophètes (Imprimerie nationale), dont l’autorité est
encore plus indéniable, répondent ceci : « On veillera à
utiliser systématiquement les capitales accentuées, y compris la
préposition À. »
![]() Il
ne sert à rien de jouer au ping-pong avec des codes-raquettes.
Quelle que soit la question traitée, je peux vous affirmer que je
trouverai toujours deux citations pour illustrer un parti et son
contraire… Encore une fois, ce qui compte, c’est la motivation des
prétendues règles. S’agissant des capitales initiales accentuées,
composer systématiquement Eve, Erasme, Ephèse
est une monstruosité pédagogique.
Il
ne sert à rien de jouer au ping-pong avec des codes-raquettes.
Quelle que soit la question traitée, je peux vous affirmer que je
trouverai toujours deux citations pour illustrer un parti et son
contraire… Encore une fois, ce qui compte, c’est la motivation des
prétendues règles. S’agissant des capitales initiales accentuées,
composer systématiquement Eve, Erasme, Ephèse
est une monstruosité pédagogique.
![]() O.
BETTENS :
Comme vous y allez…
O.
BETTENS :
Comme vous y allez…
![]() Ce
n’est pas moi qui y vais… mais la plupart des éditeurs de manuels
scolaires… C’est un des impératifs de la profession, une norme, en
quelque sorte… C’est également la norme pour les dictionnaires…
Imaginez-les sans la moindre cap accentuée et vous verrez ce que
j’entends par « monstruosité pédagogique »…
Ce
n’est pas moi qui y vais… mais la plupart des éditeurs de manuels
scolaires… C’est un des impératifs de la profession, une norme, en
quelque sorte… C’est également la norme pour les dictionnaires…
Imaginez-les sans la moindre cap accentuée et vous verrez ce que
j’entends par « monstruosité pédagogique »…
![]() Dès
lors que l’on apprend à un enfant qu’ Érasme s’écrit avec
un E accent aigu, dès lors que ses dictionnaires lui
confirmeront toujours ce petit fait, je ne vois pas bien pourquoi
on s’amuserait à lui expliquer que cet accent doit disparaître
dans la plupart des occurrences composées et dans toutes les
occurrences manuscrites… Il est vrai que je ne suis pas pédagogue…
Dès
lors que l’on apprend à un enfant qu’ Érasme s’écrit avec
un E accent aigu, dès lors que ses dictionnaires lui
confirmeront toujours ce petit fait, je ne vois pas bien pourquoi
on s’amuserait à lui expliquer que cet accent doit disparaître
dans la plupart des occurrences composées et dans toutes les
occurrences manuscrites… Il est vrai que je ne suis pas pédagogue…
![]() O.
BETTENS :
Mais cela pose à nouveau des questions fondamentales au sujet
des normes et de leurs rapports avec les usages. À mon avis, on
peut répondre de trois manières :
O.
BETTENS :
Mais cela pose à nouveau des questions fondamentales au sujet
des normes et de leurs rapports avec les usages. À mon avis, on
peut répondre de trois manières :
![]() 1.
la norme est l’usage. Autrement dit, il suffit que, au sein
d’une société donnée, on ait collectivement recours à un usage
pour qu’il acquière le statut de norme. C’est une vision que
défendraient probablement certains linguistes, mais qui ne
s’applique guère à la typographie — je ne crois pas qu’ici vous
me démentirez.
1.
la norme est l’usage. Autrement dit, il suffit que, au sein
d’une société donnée, on ait collectivement recours à un usage
pour qu’il acquière le statut de norme. C’est une vision que
défendraient probablement certains linguistes, mais qui ne
s’applique guère à la typographie — je ne crois pas qu’ici vous
me démentirez.
![]() Bien
sûr… je suis d’accord. Toutefois, les temps changent, comme disait
Bob. La composition typographique n’est plus totalement à l’abri
du vent. Il n’est pas exclu que cette vision fasse à l’avenir des
adeptes hors du cercle des linguistes.
Bien
sûr… je suis d’accord. Toutefois, les temps changent, comme disait
Bob. La composition typographique n’est plus totalement à l’abri
du vent. Il n’est pas exclu que cette vision fasse à l’avenir des
adeptes hors du cercle des linguistes.
![]() O.
BETTENS :
2. La norme est inductible à partir de l’usage. Autrement dit,
c’est en triant le « meilleur » usage du « moins
bon » qu’on arrive à dégager une norme. Ceci correspond à
la démarche des grammairiens du XVIIe
siècle, dont Grevisse est un descendant. La raison intervient
ici, mais uniquement pour décider qui est détenteur du
« bon usage », en se basant pour cela sur des critères
essentiellement non linguistiques (les plus riches, les plus
puissants, les plus instruits, les mieux nourris, etc.).
O.
BETTENS :
2. La norme est inductible à partir de l’usage. Autrement dit,
c’est en triant le « meilleur » usage du « moins
bon » qu’on arrive à dégager une norme. Ceci correspond à
la démarche des grammairiens du XVIIe
siècle, dont Grevisse est un descendant. La raison intervient
ici, mais uniquement pour décider qui est détenteur du
« bon usage », en se basant pour cela sur des critères
essentiellement non linguistiques (les plus riches, les plus
puissants, les plus instruits, les mieux nourris, etc.).
![]() Certes,
mais la comparaison est osée, car, s’agissant de la composition
typographique, le jeu de la norme et des usages fait intervenir
des contraintes que la grammaire ne connaît point et, au premier
chef, des contraintes techniques ! Oublier ce fait conduit à
se méprendre (historiquement…) sur la nature même des usages
typographiques. La non-accentuation des capitales est un bon
exemple. Que l’alinéa (renfoncement) l’ait emporté sur le sommaire
des copistes s’explique avant tout par la technique, non par le
profil des imprimeurs. Les contraintes matérielles ne sont pas les
seules oubliées dans cette affaire. Les préoccupations visuelles
ont également une certaine importance. On ne peut évoquer les
règles d’emploi des petites capitales en négligeant le rôle du
gris typographique.
Certes,
mais la comparaison est osée, car, s’agissant de la composition
typographique, le jeu de la norme et des usages fait intervenir
des contraintes que la grammaire ne connaît point et, au premier
chef, des contraintes techniques ! Oublier ce fait conduit à
se méprendre (historiquement…) sur la nature même des usages
typographiques. La non-accentuation des capitales est un bon
exemple. Que l’alinéa (renfoncement) l’ait emporté sur le sommaire
des copistes s’explique avant tout par la technique, non par le
profil des imprimeurs. Les contraintes matérielles ne sont pas les
seules oubliées dans cette affaire. Les préoccupations visuelles
ont également une certaine importance. On ne peut évoquer les
règles d’emploi des petites capitales en négligeant le rôle du
gris typographique.
![]() O.
BETTENS :
3. La norme est déductible par la raison. Autrement dit, elle
découle de règles ou de lois formulées a priori, auxquelles
l’usage doit se conformer. On trouve cette idée chez certains
théoriciens du Moyen Âge ou de la Renaissance : la graphie
de Meigret est, il me semble, une tentative (pas toujours
rationnelle) de « rationaliser » l’usage. Ce n’est que
si l’on est adepte du point 3, il me semble, que la raison doit
intervenir pour dire si un usage est bon ou non. Mais vous savez
pertinemment que, moyennant le zeste de mauvaise foi dont
personne ne peut prétendre être dépourvu, on peut trouver dix
justifications rationnelles à n’importe quel usage, d’où un
ping-pong encore plus redoutable que celui auquel vous faites
allusion. Non ?
O.
BETTENS :
3. La norme est déductible par la raison. Autrement dit, elle
découle de règles ou de lois formulées a priori, auxquelles
l’usage doit se conformer. On trouve cette idée chez certains
théoriciens du Moyen Âge ou de la Renaissance : la graphie
de Meigret est, il me semble, une tentative (pas toujours
rationnelle) de « rationaliser » l’usage. Ce n’est que
si l’on est adepte du point 3, il me semble, que la raison doit
intervenir pour dire si un usage est bon ou non. Mais vous savez
pertinemment que, moyennant le zeste de mauvaise foi dont
personne ne peut prétendre être dépourvu, on peut trouver dix
justifications rationnelles à n’importe quel usage, d’où un
ping-pong encore plus redoutable que celui auquel vous faites
allusion. Non ?
![]() Si…
avec un zeste de mauvaise foi, ce ping-pong peut être redoutable,
mais je ne crois pas que l’on puisse trouver dix justifications
rationnelles à n’importe quel usage… D’abord parce que ce n’est
pas exactement ainsi que le problème se pose : un usage
typographique n’a pas à être isolé pour être pesé à la seule aune
de la Raison. Quant à étendre la procédure à l’ensemble du
système, nul n’y songe plus. Il y a la Raison… et les raisons
(historiques, techniques, linguistiques, etc.). La Raison, en
l’espèce, consiste à examiner ces raisons…
Si…
avec un zeste de mauvaise foi, ce ping-pong peut être redoutable,
mais je ne crois pas que l’on puisse trouver dix justifications
rationnelles à n’importe quel usage… D’abord parce que ce n’est
pas exactement ainsi que le problème se pose : un usage
typographique n’a pas à être isolé pour être pesé à la seule aune
de la Raison. Quant à étendre la procédure à l’ensemble du
système, nul n’y songe plus. Il y a la Raison… et les raisons
(historiques, techniques, linguistiques, etc.). La Raison, en
l’espèce, consiste à examiner ces raisons…
![]() O.
BETTENS :
Existe-t-il des codes typographiques qui, explicitement, se
réclament d’une norme exclusivement fondée sur la Raison ?
O.
BETTENS :
Existe-t-il des codes typographiques qui, explicitement, se
réclament d’une norme exclusivement fondée sur la Raison ?
![]() Non,
évidemment. Comme je vous le disais, les typographes ont plusieurs
maîtres, dont certains, bêtement matériels, ont des raisons que la
Raison ne connaît pas.
Non,
évidemment. Comme je vous le disais, les typographes ont plusieurs
maîtres, dont certains, bêtement matériels, ont des raisons que la
Raison ne connaît pas.
![]() O.
BETTENS :
N’est-ce pas à eux seuls qu’on pourrait reprocher, s’ils
n’expliquent pas, d’édicter une « loi typographique
immanente » ?
O.
BETTENS :
N’est-ce pas à eux seuls qu’on pourrait reprocher, s’ils
n’expliquent pas, d’édicter une « loi typographique
immanente » ?
![]() Pourquoi ?
Une loi immanente n’est pas nécessairement raisonnable.
Pourquoi ?
Une loi immanente n’est pas nécessairement raisonnable.
![]() O.
BETTENS :
Si l’on prend pour modèle le point 2 (ce qui me semble assez…
raisonnable), peu d’explications sont nécessaires : il
reste à savoir qui sont les bons (ou les meilleurs) typographes.
Ceux qui ont le meilleur salaire ? Ceux qui rédigent les
codes typographiques ? Ceux qui impriment les plus beaux
livres ? Ou ceux qui accentuent les capitales
initiales ?
O.
BETTENS :
Si l’on prend pour modèle le point 2 (ce qui me semble assez…
raisonnable), peu d’explications sont nécessaires : il
reste à savoir qui sont les bons (ou les meilleurs) typographes.
Ceux qui ont le meilleur salaire ? Ceux qui rédigent les
codes typographiques ? Ceux qui impriment les plus beaux
livres ? Ou ceux qui accentuent les capitales
initiales ?
![]() Vous
venez de démontrer que, s’agissant de la composition
typographique, le point 2 n’est pas encore opérationnel… Pour
conclure… La distinction des trois processus que vous décrivez est
bien sûr irréprochable si l’on s’en tient à la norme et aux usages
strictement linguistiques… mais, dès lors que la typographie entre
en scène, la validité est sérieusement mise à mal par l’oubli des
pesanteurs matérielles et des impératifs visuels…
Vous
venez de démontrer que, s’agissant de la composition
typographique, le point 2 n’est pas encore opérationnel… Pour
conclure… La distinction des trois processus que vous décrivez est
bien sûr irréprochable si l’on s’en tient à la norme et aux usages
strictement linguistiques… mais, dès lors que la typographie entre
en scène, la validité est sérieusement mise à mal par l’oubli des
pesanteurs matérielles et des impératifs visuels…
![]() O.
BETTENS :
Pour les entrées en capitales, c’est indéniable. Mais pour les
initiales, c’est une autre chanson. Si les accentuer est une
norme, alors elle est très récente.
O.
BETTENS :
Pour les entrées en capitales, c’est indéniable. Mais pour les
initiales, c’est une autre chanson. Si les accentuer est une
norme, alors elle est très récente.
![]() Oui…
mais elle est largement respectée…
Oui…
mais elle est largement respectée…
![]() Renseignez-vous
auprès d’éditeurs de manuels scolaires (Nathan, Bordas, etc.) ou
de dictionnaires (Larousse, Robert, Hachette, etc.)…
Renseignez-vous
auprès d’éditeurs de manuels scolaires (Nathan, Bordas, etc.) ou
de dictionnaires (Larousse, Robert, Hachette, etc.)…
![]() O.
BETTENS :
J’ai deux éditions du (Nouveau !) Petit
Larousse datant des années 1955-1965 (je n’en ai pas de plus
récentes) qui n’accentuent pas les majuscules initiales dans le
corps du texte.
O.
BETTENS :
J’ai deux éditions du (Nouveau !) Petit
Larousse datant des années 1955-1965 (je n’en ai pas de plus
récentes) qui n’accentuent pas les majuscules initiales dans le
corps du texte.
![]() Oui…
mais c’est une époque révolue…
Oui…
mais c’est une époque révolue…
![]() O.
BETTENS :
Personnellement, j’éprouve une certaine méfiance pour les normes
datant de… moins d’un demi-siècle. J’ai tendance à les mettre au
« purgatoire » des possibles normes futures. Mais il
est vrai que je n’imprime ni dictionnaire ni livre scolaire et
j’admets que ceux qui sont actifs dans ce domaine soient plus
pressés que moi.
O.
BETTENS :
Personnellement, j’éprouve une certaine méfiance pour les normes
datant de… moins d’un demi-siècle. J’ai tendance à les mettre au
« purgatoire » des possibles normes futures. Mais il
est vrai que je n’imprime ni dictionnaire ni livre scolaire et
j’admets que ceux qui sont actifs dans ce domaine soient plus
pressés que moi.
![]() Rien
à redire… Comme vous le savez peut-être, je suis un défenseur
obstiné des libertés individuelles ! Pour moi, nul n’est tenu
de respecter les normes et les usages… Chacun fait comme il
l’entend et le voit… et chacun en assume les conséquences…
Rien
à redire… Comme vous le savez peut-être, je suis un défenseur
obstiné des libertés individuelles ! Pour moi, nul n’est tenu
de respecter les normes et les usages… Chacun fait comme il
l’entend et le voit… et chacun en assume les conséquences…
![]() O.
BETTENS :
En fait de monstruosité, j’ai connu bien pire.
O.
BETTENS :
En fait de monstruosité, j’ai connu bien pire.
![]() Moi
aussi… Bon, je retire « monstruosité » et vous propose
« maladresse pédagogique ».
Moi
aussi… Bon, je retire « monstruosité » et vous propose
« maladresse pédagogique ».
![]() O.
BETTENS :
Si je comprends bien, vous expliqueriez l’absence (ou la rareté)
des majuscules initiales accentuées dans les imprimés
relativement anciens par des limitations d’ordre technique…
O.
BETTENS :
Si je comprends bien, vous expliqueriez l’absence (ou la rareté)
des majuscules initiales accentuées dans les imprimés
relativement anciens par des limitations d’ordre technique…
![]() Oui,
partiellement : fragilité du crénage, problèmes
d’interlignage, etc. Mais je n’oublie pas les paramètres
historiques et linguistiques.
Oui,
partiellement : fragilité du crénage, problèmes
d’interlignage, etc. Mais je n’oublie pas les paramètres
historiques et linguistiques.
![]() O.
BETTENS :
Ce qui revient à peu près à dire : « Si nos anciens
typographes avaient disposé des possibilités techniques dont
nous disposons aujourd’hui, ils se seraient empressés
d’accentuer toutes les initiales. » Ou vais-je trop
loin ?
O.
BETTENS :
Ce qui revient à peu près à dire : « Si nos anciens
typographes avaient disposé des possibilités techniques dont
nous disposons aujourd’hui, ils se seraient empressés
d’accentuer toutes les initiales. » Ou vais-je trop
loin ?
![]() Oui
et non.
Oui
et non.
![]() Non,
ce que j’ai écrit ne revient pas à dire à peu près ce que vous
dites…
Non,
ce que j’ai écrit ne revient pas à dire à peu près ce que vous
dites…
![]() Oui,
vous allez un peu loin… car je n’explique pas tout par les
contraintes techniques ; je me borne à leur accorder
l’attention qu’elles méritent. Toutefois, ce que vous me proposez
comme corollaire n’est pas dénué de fondement historique : de
nombreux typographes du XVIIe
et du XVIIIe siècle
se sont évertués à contourner les contraintes matérielles en
bricolant des accents au coup par coup ou en employant des fontes
dans lesquelles les accents étaient placés sur le côté de la
lettre : E´.
Oui,
vous allez un peu loin… car je n’explique pas tout par les
contraintes techniques ; je me borne à leur accorder
l’attention qu’elles méritent. Toutefois, ce que vous me proposez
comme corollaire n’est pas dénué de fondement historique : de
nombreux typographes du XVIIe
et du XVIIIe siècle
se sont évertués à contourner les contraintes matérielles en
bricolant des accents au coup par coup ou en employant des fontes
dans lesquelles les accents étaient placés sur le côté de la
lettre : E´.
![]() O.
BETTENS :
Je reconnais bien sûr l’intérêt d’une prise en compte des
aspects techniques pour expliquer un style (dans le domaine de
la musique instrumentale, par exemple, connaître les
possibilités techniques des instruments pour lesquels les
compositeurs anciens ont écrit, est une aide extrêmement
appréciable à la compréhension de la musique elle-même). Mais…
Mais, je pense que la contrainte (qu’elle soit ou non
matérielle) est consubstantielle à l’idée même de style.
Autrement dit, qu’un trait particulier à un style donné soit ou
non lié à une contrainte matérielle n’atténue en rien le fait
que ce trait est partie intégrante dudit style et participe de
son équilibre. J’aurais donc envie de dire que si, dans le
style, mettons, « roman policier des années trente »,
on trouve fort peu de majuscules initiales accentuées (je n’ai
pas vérifié), ajouter de tels accents dans une réédition serait
une faute de style. De la même manière, utiliser à l’ordinateur
la police Courier, donc évoquant la machine à écrire, en lui
ajoutant des gadgets que la bonne vieille machine à écrire ne
possédait pas me paraît aussi une faute de style. L’analogie
dont je me sers est ici artistique (et même musicale) et non
grammaticale (je suis bien obligé de me servir d’analogies,
comme je ne suis pas typographe). Est-elle parlante ?
Est-elle recevable par un typographe ?
O.
BETTENS :
Je reconnais bien sûr l’intérêt d’une prise en compte des
aspects techniques pour expliquer un style (dans le domaine de
la musique instrumentale, par exemple, connaître les
possibilités techniques des instruments pour lesquels les
compositeurs anciens ont écrit, est une aide extrêmement
appréciable à la compréhension de la musique elle-même). Mais…
Mais, je pense que la contrainte (qu’elle soit ou non
matérielle) est consubstantielle à l’idée même de style.
Autrement dit, qu’un trait particulier à un style donné soit ou
non lié à une contrainte matérielle n’atténue en rien le fait
que ce trait est partie intégrante dudit style et participe de
son équilibre. J’aurais donc envie de dire que si, dans le
style, mettons, « roman policier des années trente »,
on trouve fort peu de majuscules initiales accentuées (je n’ai
pas vérifié), ajouter de tels accents dans une réédition serait
une faute de style. De la même manière, utiliser à l’ordinateur
la police Courier, donc évoquant la machine à écrire, en lui
ajoutant des gadgets que la bonne vieille machine à écrire ne
possédait pas me paraît aussi une faute de style. L’analogie
dont je me sers est ici artistique (et même musicale) et non
grammaticale (je suis bien obligé de me servir d’analogies,
comme je ne suis pas typographe). Est-elle parlante ?
Est-elle recevable par un typographe ?
![]() Bien
sûr. Je suis d’accord avec tout ce qui précède (sauf sur les
rééditions de polars)… mais nous ne parlons plus de la même chose…
Les relations entre la norme, l’usage, les contraintes et le style
sont riches… même en typographie. Il arrive qu’un style se
caractérise en partie par un respect scrupuleux de certaines
contraintes réelles ou obsolètes. À l’inverse, par exemple, des
typographes dadaïstes se plaisaient à éliminer toutes les
capitales. Loin de moi l’idée de critiquer semblable parti en
l’opposant à une norme quelconque, puisque ce parti se charge
lui-même de la confrontation et en joue.
Bien
sûr. Je suis d’accord avec tout ce qui précède (sauf sur les
rééditions de polars)… mais nous ne parlons plus de la même chose…
Les relations entre la norme, l’usage, les contraintes et le style
sont riches… même en typographie. Il arrive qu’un style se
caractérise en partie par un respect scrupuleux de certaines
contraintes réelles ou obsolètes. À l’inverse, par exemple, des
typographes dadaïstes se plaisaient à éliminer toutes les
capitales. Loin de moi l’idée de critiquer semblable parti en
l’opposant à une norme quelconque, puisque ce parti se charge
lui-même de la confrontation et en joue.
![]() Disons
que, par nature, le style « manuel scolaire » est moins
librement subversif…
Disons
que, par nature, le style « manuel scolaire » est moins
librement subversif…
![]() O.
BETTENS :
La comparaison a ses limites. Mais j’ai tout de même de la peine
à imaginer comment la ou les normes typographiques pourraient
émerger autrement qu’à partir de l’usage et de la tradition.
J’ai tendance à me méfier comme de la peste des choses qui sont
parachutées juste parce qu’elles sont techniquement possibles,
alors qu’elles ne l’étaient pas (ou étaient difficiles)
auparavant.
O.
BETTENS :
La comparaison a ses limites. Mais j’ai tout de même de la peine
à imaginer comment la ou les normes typographiques pourraient
émerger autrement qu’à partir de l’usage et de la tradition.
J’ai tendance à me méfier comme de la peste des choses qui sont
parachutées juste parce qu’elles sont techniquement possibles,
alors qu’elles ne l’étaient pas (ou étaient difficiles)
auparavant.
![]() Tout
à fait d’accord. Toutefois, il ne faut pas oublier l’autre
versant : méfions-nous également des normes déraisonnables,
et engendrées jadis par des contraintes techniques qui n’existent
plus…
Tout
à fait d’accord. Toutefois, il ne faut pas oublier l’autre
versant : méfions-nous également des normes déraisonnables,
et engendrées jadis par des contraintes techniques qui n’existent
plus…
![]() À
France-Langue, le 5 août 1998.
À
France-Langue, le 5 août 1998.
![]() M.
CROCQ :
Quant aux capitales accentuées ou non dans les pages
rédactionnelles… le problème se pose dans de nombreux journaux,
ce qui est logique lorsque l’on sait que tout bachelier français
a appris pour seule et unique règle orthotypographique dans
toute sa scolarité : « Pas d’accent sur les
majuscules » (sans distinction d’avec les capitales,
d’ailleurs).
M.
CROCQ :
Quant aux capitales accentuées ou non dans les pages
rédactionnelles… le problème se pose dans de nombreux journaux,
ce qui est logique lorsque l’on sait que tout bachelier français
a appris pour seule et unique règle orthotypographique dans
toute sa scolarité : « Pas d’accent sur les
majuscules » (sans distinction d’avec les capitales,
d’ailleurs).
![]() Certes…
mais vous êtes trop indulgent avec les professionnels du secteur…
Certes…
mais vous êtes trop indulgent avec les professionnels du secteur…
![]() Dans
tout processus d’édition, il y a… ou il devrait y avoir… en
principe… au moins un individu ayant entendu parler de typographie
ailleurs qu’à la maternelle ou au lycée (je ne parle évidemment
pas d’Estienne et de quelques autres…)…
Dans
tout processus d’édition, il y a… ou il devrait y avoir… en
principe… au moins un individu ayant entendu parler de typographie
ailleurs qu’à la maternelle ou au lycée (je ne parle évidemment
pas d’Estienne et de quelques autres…)…
![]() J’en
connais qui n’hésitent pas à mettre en avant des choix esthétiques
pour justifier un simple mais légitime désir de ne pas se
compliquer la vie…
J’en
connais qui n’hésitent pas à mettre en avant des choix esthétiques
pour justifier un simple mais légitime désir de ne pas se
compliquer la vie…
![]() À
Typographie, le 26 octobre 1998.
À
Typographie, le 26 octobre 1998.
![]() T.
PEACH :
Or, tout en ayant la permission de garder l’accent sur les E,
j’ai dû systématiquement l’enlever sur les A (règles de
la Maison oblige). Que faire ?
T.
PEACH :
Or, tout en ayant la permission de garder l’accent sur les E,
j’ai dû systématiquement l’enlever sur les A (règles de
la Maison oblige). Que faire ?
![]() Respecter
les règles de la Maison… et tout faire (avec ou sans espoir) pour
qu’elles changent…
Respecter
les règles de la Maison… et tout faire (avec ou sans espoir) pour
qu’elles changent…
![]() T.
BOUCHE :
[…] Je suspecte plutôt une question d’habitude.
T.
BOUCHE :
[…] Je suspecte plutôt une question d’habitude.
![]() Oui…
et bien ancrée ! Pendant des siècles, la plupart des polices
de labeur n’ont pas eu de À (A cap accent grave)… ni d’ailleurs
aucune cap accentuée… à l’exception des E (accents grave, aigu,
circonflexe)… Seules ces trois dernières avaient leur cassetin
dans la quasi-totalité des modèles de casse de labeur ! Même
chose pour les petites caps ! Voir aussi les polices (listes
des quantités) de labeur… Kif-kif !
Oui…
et bien ancrée ! Pendant des siècles, la plupart des polices
de labeur n’ont pas eu de À (A cap accent grave)… ni d’ailleurs
aucune cap accentuée… à l’exception des E (accents grave, aigu,
circonflexe)… Seules ces trois dernières avaient leur cassetin
dans la quasi-totalité des modèles de casse de labeur ! Même
chose pour les petites caps ! Voir aussi les polices (listes
des quantités) de labeur… Kif-kif !
![]() Faut
pas se gourer… c’est les tenants du « A préposition
nu-tête » qui ont les gros bataillons plombés de la Tradition
pour eux… Nous, on a la Raison et les maîtres ! C’est
mieux !
Faut
pas se gourer… c’est les tenants du « A préposition
nu-tête » qui ont les gros bataillons plombés de la Tradition
pour eux… Nous, on a la Raison et les maîtres ! C’est
mieux !
![]() T.
BOUCHE :
Bien sûr, faudrait l’améliorer dans le cas où seul le A
a perdu son accent.
T.
BOUCHE :
Bien sûr, faudrait l’améliorer dans le cas où seul le A
a perdu son accent.
![]() À
tout faux, un original ! (Ducon, critique d’art.)
À
tout faux, un original ! (Ducon, critique d’art.)
![]() A
tout faux, un original ! (Ducon, prof de maths.)
A
tout faux, un original ! (Ducon, prof de maths.)
J.-P. Ducon (orthotypographe).
![]() À
Typographie, le 15 juin 1999.
À
Typographie, le 15 juin 1999.
![]() P.
JALLON :
Pour les sigles, je n’accentuerais pas là où je ne
« prononce » pas l’accent.
P.
JALLON :
Pour les sigles, je n’accentuerais pas là où je ne
« prononce » pas l’accent.
![]() Tu
nous racontes la blague de l’œuf et de la poule ? Il faudrait
accentuer les sigles (quand on épelle, on épelle, inutile de se
compliquer la vie ou d’inciter l’usager à écrire electricité)…
La question d’un éventuel écart ne devrait se poser qu’avec
certains acronymes (car les accents s’y retrouvent parfois en
fâcheuse posture ou peuvent engendrer des difficultés de
prononciation…).
Tu
nous racontes la blague de l’œuf et de la poule ? Il faudrait
accentuer les sigles (quand on épelle, on épelle, inutile de se
compliquer la vie ou d’inciter l’usager à écrire electricité)…
La question d’un éventuel écart ne devrait se poser qu’avec
certains acronymes (car les accents s’y retrouvent parfois en
fâcheuse posture ou peuvent engendrer des difficultés de
prononciation…).
![]() À
F.L.L.F., le 19 janvier 2000.
À
F.L.L.F., le 19 janvier 2000.
![]() B.
T. HIGONNET :
Maintenant qu’il est techniquement facile d’accentuer les
majuscules, pourquoi ne pas les utiliser ?
B.
T. HIGONNET :
Maintenant qu’il est techniquement facile d’accentuer les
majuscules, pourquoi ne pas les utiliser ?
![]() C’est
simple… Pour pas se compliquer la vie… (Pas de quiproquo… Je suis
férocement pour les complications qui facilitent la vie du
lecteur !)
C’est
simple… Pour pas se compliquer la vie… (Pas de quiproquo… Je suis
férocement pour les complications qui facilitent la vie du
lecteur !)
![]() À
Typographie, le 3 octobre 2000.
À
Typographie, le 3 octobre 2000.
![]() OUDIN-SHANNON :
Les lois et règlements sont nécessaires, sans eux il n’y aurait
pas possibilité de transgression.
OUDIN-SHANNON :
Les lois et règlements sont nécessaires, sans eux il n’y aurait
pas possibilité de transgression.
![]() Cela
est certain, beau et même fondamental. Toutefois, d’autres raisons
motivent quelques règles. Si celle que vous évoquez était isolée,
sa beauté ne la mettrait pas à l’abri du néant. Plus la règle
exceptionnellement transgressée est motivée, plus l’exceptionnelle
transgression motivée est belle. On appelle cela un écart
maîtrisé. Les transgressions systématiques (volontaires ou non) de
règles ou de conventions motivées, c’est autre chose. La plupart
portent un nom malsonnant.
Cela
est certain, beau et même fondamental. Toutefois, d’autres raisons
motivent quelques règles. Si celle que vous évoquez était isolée,
sa beauté ne la mettrait pas à l’abri du néant. Plus la règle
exceptionnellement transgressée est motivée, plus l’exceptionnelle
transgression motivée est belle. On appelle cela un écart
maîtrisé. Les transgressions systématiques (volontaires ou non) de
règles ou de conventions motivées, c’est autre chose. La plupart
portent un nom malsonnant.
![]() Quant
à l’abandon de règles ou de conventions typographiques non
motivées ou démotivées, c’est encore autre chose et, le plus
souvent, ce n’est plus une transgression.
Quant
à l’abandon de règles ou de conventions typographiques non
motivées ou démotivées, c’est encore autre chose et, le plus
souvent, ce n’est plus une transgression.
![]() OUDIN-SHANNON :
Libération a supprimé les espaces liées à la ponctuation.
Je ne suis actuellement pas d’accord avec leur usage, mais j’y
vois quand même quelques raisons autres qu’une simple ignorance
des règles.
OUDIN-SHANNON :
Libération a supprimé les espaces liées à la ponctuation.
Je ne suis actuellement pas d’accord avec leur usage, mais j’y
vois quand même quelques raisons autres qu’une simple ignorance
des règles.
![]() Moi
aussi… mais aucune n’exclut celle-là.
Moi
aussi… mais aucune n’exclut celle-là.
![]() OUDIN-SHANNON :
Si quelqu’un veut composer aujourd’hui É. D. F. libre à
lui !
OUDIN-SHANNON :
Si quelqu’un veut composer aujourd’hui É. D. F. libre à
lui !
![]() Profitant
partiellement de cette liberté, je compose É.D.F. Le plus drôle,
c’est que je sais pourquoi. Un comble.
Profitant
partiellement de cette liberté, je compose É.D.F. Le plus drôle,
c’est que je sais pourquoi. Un comble.
![]() OUDIN-SHANNON :
Je trouve un peu court de rejeter automatiquement toute nouvelle
pratique.
OUDIN-SHANNON :
Je trouve un peu court de rejeter automatiquement toute nouvelle
pratique.
![]() Provocateur…
Remarque mesquine ? Oui, sans conteste. Mais rassurez- vous,
je ne suis pas mesquin par dogme. J’ai parfois des crises aiguës,
par exemple quand je lis que ceux qui récusent l’abandon
irréfléchi du point abréviatif rejettent
« automatiquement » toute nouvelle pratique. C’est un
peu court, jeune homme
Provocateur…
Remarque mesquine ? Oui, sans conteste. Mais rassurez- vous,
je ne suis pas mesquin par dogme. J’ai parfois des crises aiguës,
par exemple quand je lis que ceux qui récusent l’abandon
irréfléchi du point abréviatif rejettent
« automatiquement » toute nouvelle pratique. C’est un
peu court, jeune homme
![]() À
F.L.L.F., le 22 mai 2001.
À
F.L.L.F., le 22 mai 2001.
![]() P.
CAZAUX :
Je ne joue pas. Donnez-moi une bonne raison d’accentuer tout
sauf les majuscules.
P.
CAZAUX :
Je ne joue pas. Donnez-moi une bonne raison d’accentuer tout
sauf les majuscules.
![]() Tu
perds ton temps, camarade… Laisse pisser. Laisse causer… Posée en
ces termes, la question de l’accentuation des majuscules et des
capitales n’a, aujourd’hui, que peu d’intérêt. S’appuyer sur
l’histoire de la chose imprimée, sur des traditions diverses, sur
les habitudes de quidams d’ici ou là, sur la distinction
écriture/typographie, sur l’élimination d’éventuelles ambiguïtés
est désormais secondaire. (Il y a quinze ans, voire cinq, je ne
dis pas… De toute façon, à l’époque, ces « appuis »
rendaient déjà le même verdict…)
Tu
perds ton temps, camarade… Laisse pisser. Laisse causer… Posée en
ces termes, la question de l’accentuation des majuscules et des
capitales n’a, aujourd’hui, que peu d’intérêt. S’appuyer sur
l’histoire de la chose imprimée, sur des traditions diverses, sur
les habitudes de quidams d’ici ou là, sur la distinction
écriture/typographie, sur l’élimination d’éventuelles ambiguïtés
est désormais secondaire. (Il y a quinze ans, voire cinq, je ne
dis pas… De toute façon, à l’époque, ces « appuis »
rendaient déjà le même verdict…)
![]() Le
monde bouge. Aujourd’hui, la majorité (demain, la quasi-totalité)
de ce qui s’« écrit » ne s’inscrit plus dans le couple
traditionnel « écriture manuscrite »/ composition
typographique. C’est fini, n, i, ni. Aujourd’hui, on saisit des
caractères (codés…), les textes ne sont plus des ensembles
inertes, figés, fixés comme naguère dans des glyphes de
circonstance, dans des formes immuables sauf à tout se retaper…
Laisse les archaïques (qu’ils soient directeurs artistiques,
éditeurs, mandarins ou simples pékins) patauger, pédaler,
s’enfoncer dans la vase, leur agonie sera brève. Tout concourt à
l’accentuation systématique : la réversibilité des casses, la
souplesse de la mise en forme à partir d’un même fichier, le
passage d’un support à un autre, l’indexation, la recherche, la
correction automatique, etc.
Le
monde bouge. Aujourd’hui, la majorité (demain, la quasi-totalité)
de ce qui s’« écrit » ne s’inscrit plus dans le couple
traditionnel « écriture manuscrite »/ composition
typographique. C’est fini, n, i, ni. Aujourd’hui, on saisit des
caractères (codés…), les textes ne sont plus des ensembles
inertes, figés, fixés comme naguère dans des glyphes de
circonstance, dans des formes immuables sauf à tout se retaper…
Laisse les archaïques (qu’ils soient directeurs artistiques,
éditeurs, mandarins ou simples pékins) patauger, pédaler,
s’enfoncer dans la vase, leur agonie sera brève. Tout concourt à
l’accentuation systématique : la réversibilité des casses, la
souplesse de la mise en forme à partir d’un même fichier, le
passage d’un support à un autre, l’indexation, la recherche, la
correction automatique, etc.
![]() Quant
au « C’est mon choix ! nananère ! mon
opinion ! et je ne suis pas le seul à la partager ! mon
instituteur et ma grand-mère sont sur la même longueur
d’onde ! », qu’est-ce qu’on en a à cirer ? Chacun
est libre d’écrire (de parler, de penser…) comme il le souhaite.
Chacun est libre d’être fier de ses petites ankyloses.
Quant
au « C’est mon choix ! nananère ! mon
opinion ! et je ne suis pas le seul à la partager ! mon
instituteur et ma grand-mère sont sur la même longueur
d’onde ! », qu’est-ce qu’on en a à cirer ? Chacun
est libre d’écrire (de parler, de penser…) comme il le souhaite.
Chacun est libre d’être fier de ses petites ankyloses.
VI.
Capitales accentuées :
histoire et pratiques
![]() À
Typographie, le 27 juin 1997.
À
Typographie, le 27 juin 1997.
![]() À
mon sens (juste pour caser un À…), l’absence regrettable et
séculaire de l’accent sur le A capitale n’est pas due à une raison
d’ordre « esthétique ».
À
mon sens (juste pour caser un À…), l’absence regrettable et
séculaire de l’accent sur le A capitale n’est pas due à une raison
d’ordre « esthétique ».
![]() D’abord,
mais ça n’explique pas tout, l’ajout (et surtout l’adoption) de
l’accent diacritique sur la préposition « à » est plus
tardif que l’accentuation de beaucoup de E initiaux.
D’abord,
mais ça n’explique pas tout, l’ajout (et surtout l’adoption) de
l’accent diacritique sur la préposition « à » est plus
tardif que l’accentuation de beaucoup de E initiaux.
![]() Plus
décisif est le fait qu’en composition chaude le A accentué est
(était…) encore plus fragile que les E accentués. Sur les E,
l’accent, grave, aigu ou circonflexe, « s’appuie » sur
une vigoureuse horizontale. Sur le A, le malheureux accent grave
ne rencontre qu’un angle (aigu…). Lors du serrage de la
composition, le crénage pète facilement, plus facilement que sur
les E. Ajoutez à cela le fait que l’absence d’accent sur la
préposition « à » en position initiale engendre rarement
(jamais ?) une ambiguïté…
Plus
décisif est le fait qu’en composition chaude le A accentué est
(était…) encore plus fragile que les E accentués. Sur les E,
l’accent, grave, aigu ou circonflexe, « s’appuie » sur
une vigoureuse horizontale. Sur le A, le malheureux accent grave
ne rencontre qu’un angle (aigu…). Lors du serrage de la
composition, le crénage pète facilement, plus facilement que sur
les E. Ajoutez à cela le fait que l’absence d’accent sur la
préposition « à » en position initiale engendre rarement
(jamais ?) une ambiguïté…
![]() Mais
ces histoires de crénage (physique…), c’est de la préhistoire…
Alors, aujourd’hui, si l’interlignage permet de caser les E
accentués, il n’y a aucune raison (sérieuse…) pour ne pas caser
les À…
Mais
ces histoires de crénage (physique…), c’est de la préhistoire…
Alors, aujourd’hui, si l’interlignage permet de caser les E
accentués, il n’y a aucune raison (sérieuse…) pour ne pas caser
les À…
![]() À
France-Langue, le 18 mars 1998.
À
France-Langue, le 18 mars 1998.
![]() H.
FAVE :
D’après le Manuel de typographie élémentaire d’Yves
Perrousseaux : « (À) la fin du siècle dernier […] en
imprimerie, les machines composeuses […] étant de conception
anglo-saxonne, ne comportaient pas de capitales accentuées
puisque la langue anglaise n’en comporte pas »…
H.
FAVE :
D’après le Manuel de typographie élémentaire d’Yves
Perrousseaux : « (À) la fin du siècle dernier […] en
imprimerie, les machines composeuses […] étant de conception
anglo-saxonne, ne comportaient pas de capitales accentuées
puisque la langue anglaise n’en comporte pas »…
![]() Curieuse
démonstration… Sur le même schéma : la langue anglaise ne
comportant (sic) pas de bas de casse accentués, nos
Linotypes et nos Monotypes d’origine américaine ont été incapables
d’accentuer les minuscules…
Curieuse
démonstration… Sur le même schéma : la langue anglaise ne
comportant (sic) pas de bas de casse accentués, nos
Linotypes et nos Monotypes d’origine américaine ont été incapables
d’accentuer les minuscules…
![]() H.
FAVE :
« Et dans les secrétariats, dès leur apparition, les
machines à écrire (alors à frappe mécanique) ne comportaient pas
de capitales accentuées non plus, car elles étaient elles aussi
de conception anglo-saxonne. »
H.
FAVE :
« Et dans les secrétariats, dès leur apparition, les
machines à écrire (alors à frappe mécanique) ne comportaient pas
de capitales accentuées non plus, car elles étaient elles aussi
de conception anglo-saxonne. »
![]() La
dactylographie et la composition typographique, ça fait deux.
Pendant le siècle où les machines à écrire ont envahi les bureaux,
on n’a pas assisté à l’élimination de toutes les subtilités
typographiques qu’elles étaient incapables de reproduire… En
outre, attribuer une partie de la responsabilité du défaut
d’accentuation à la dactylographie est un procédé discutable…
quand on écrit à l’aide d’un clavier d’ordinateur. Il suffit de
consulter d’anciens documents pour apprécier le mal de chien que
se donnaient les pauvres premières dactylos pour entrer des
succédanés d’accents (placement d’une virgule au sommet d’un E,
par exemple…).
La
dactylographie et la composition typographique, ça fait deux.
Pendant le siècle où les machines à écrire ont envahi les bureaux,
on n’a pas assisté à l’élimination de toutes les subtilités
typographiques qu’elles étaient incapables de reproduire… En
outre, attribuer une partie de la responsabilité du défaut
d’accentuation à la dactylographie est un procédé discutable…
quand on écrit à l’aide d’un clavier d’ordinateur. Il suffit de
consulter d’anciens documents pour apprécier le mal de chien que
se donnaient les pauvres premières dactylos pour entrer des
succédanés d’accents (placement d’une virgule au sommet d’un E,
par exemple…).
![]() H.
FAVE :
« Pendant un siècle on a justifié ces contraintes
techniques par cette idée reçue idiote, alors qu’il aurait été
plus honnête de reconnaître : “On ne peut pas mettre les
accents sur les capitales parce que les machines ne le
permettent pas.” Ce que les praticiens étaient les seuls à
savoir. »
H.
FAVE :
« Pendant un siècle on a justifié ces contraintes
techniques par cette idée reçue idiote, alors qu’il aurait été
plus honnête de reconnaître : “On ne peut pas mettre les
accents sur les capitales parce que les machines ne le
permettent pas.” Ce que les praticiens étaient les seuls à
savoir. »
![]() Cela
n’aurait pas été plus « honnête » puisque c’est
faux ! La preuve : pendant le siècle en question, on a
accentué des capitales… même en composition mécanique. L’absence
d’accent sur les caps n’est pas un problème de
« machine » mais de police (c’est-à-dire de matrices sur
Linotype, de disque en photocompo, d’octets en P.A.O…), de police
foireuse. Même sur Linotype, on pouvait toujours tourner certaines
difficultés en composant en petites caps d’un corps supérieur.
Quant à la photocomposition, des spécialistes pourraient expliquer
comment on bricolait des accents sur les disques incomplets.
Cela
n’aurait pas été plus « honnête » puisque c’est
faux ! La preuve : pendant le siècle en question, on a
accentué des capitales… même en composition mécanique. L’absence
d’accent sur les caps n’est pas un problème de
« machine » mais de police (c’est-à-dire de matrices sur
Linotype, de disque en photocompo, d’octets en P.A.O…), de police
foireuse. Même sur Linotype, on pouvait toujours tourner certaines
difficultés en composant en petites caps d’un corps supérieur.
Quant à la photocomposition, des spécialistes pourraient expliquer
comment on bricolait des accents sur les disques incomplets.
![]() À
F.L.L.F, le 31 mars 2000.
À
F.L.L.F, le 31 mars 2000.
![]() J.-M.
GAUDIN :
Deux raisons historiques à cela. La première, c’est que les
machines à écrire ne le permettaient pas. La deuxième est que
les rotatives avec des caractères en plomb usaient la partie
haute des lettres ce qui posait problème pour les éditions bon
marché, d’où suppression des majuscules accentuées pour icelles.
J.-M.
GAUDIN :
Deux raisons historiques à cela. La première, c’est que les
machines à écrire ne le permettaient pas. La deuxième est que
les rotatives avec des caractères en plomb usaient la partie
haute des lettres ce qui posait problème pour les éditions bon
marché, d’où suppression des majuscules accentuées pour icelles.
![]() Oh
non… c’est inexact.
Oh
non… c’est inexact.
![]() La
dactylographie n’explique en rien le défaut d’accentuation des
majuscules, phénomène certes regrettable mais beaucoup plus ancien
qu’elle. Les typographes d’antan accentuaient les capitales… mais
pas toujours et, surtout, pas toutes. Les raisons techniques
(proprement typographiques) et linguistiques ne manquent pas. Les
machines à écrire (et les instituteurs…) expliquent seulement le
fait que trop de gens pensent encore qu’il ne faut pas accentuer
les capitales, ce qui est bien différent…
La
dactylographie n’explique en rien le défaut d’accentuation des
majuscules, phénomène certes regrettable mais beaucoup plus ancien
qu’elle. Les typographes d’antan accentuaient les capitales… mais
pas toujours et, surtout, pas toutes. Les raisons techniques
(proprement typographiques) et linguistiques ne manquent pas. Les
machines à écrire (et les instituteurs…) expliquent seulement le
fait que trop de gens pensent encore qu’il ne faut pas accentuer
les capitales, ce qui est bien différent…
![]() Quant
aux rotatives… eh bien, elles ne risquent guère d’user les
« caractères en plomb », puisqu’elles ne les fréquentent
pas… Une rotative imprime par le biais d’un cliché courbe fixé sur
un cylindre. Bien entendu, ce cliché s’use lors des tirages
importants. Pas de problème : il a été obtenu à partir d’un
flan qui lui-même était le moulage de la forme typographique.
Quant
aux rotatives… eh bien, elles ne risquent guère d’user les
« caractères en plomb », puisqu’elles ne les fréquentent
pas… Une rotative imprime par le biais d’un cliché courbe fixé sur
un cylindre. Bien entendu, ce cliché s’use lors des tirages
importants. Pas de problème : il a été obtenu à partir d’un
flan qui lui-même était le moulage de la forme typographique.
![]() À
Typographie, du 2 au 3 octobre 2000.
À
Typographie, du 2 au 3 octobre 2000.
![]() OUDIN-SHANNON :
On trouve dans le guide de Théotiste Lefevre l’exemple d’une
couverture de livre (page 128) où l’on peut lire : CHIMIE
ÉLÉMENTAIRE et plus loin : A ROUENS sans accent
sur le A.
OUDIN-SHANNON :
On trouve dans le guide de Théotiste Lefevre l’exemple d’une
couverture de livre (page 128) où l’on peut lire : CHIMIE
ÉLÉMENTAIRE et plus loin : A ROUENS sans accent
sur le A.
![]() Oui,
à l’exception classique de ce A, toutes les capitales de
cette page de grand titre sont accentuées… C’est bien ce que vous
vouliez démontrer ? À moins que cette référence ne vise
également à nous suggérer d’écrire encore « A ROUENS »
ou de mettre un point final aux pages de titre ? Allez
jusqu’à la page 134, vous y découvrirez une charmante
« HÉLOÏSE ». Je ne crois pas que ce Ï soit un E.
Oui,
à l’exception classique de ce A, toutes les capitales de
cette page de grand titre sont accentuées… C’est bien ce que vous
vouliez démontrer ? À moins que cette référence ne vise
également à nous suggérer d’écrire encore « A ROUENS »
ou de mettre un point final aux pages de titre ? Allez
jusqu’à la page 134, vous y découvrirez une charmante
« HÉLOÏSE ». Je ne crois pas que ce Ï soit un E.
![]() OUDIN-SHANNON :
Il n’existerait aucun argument pour ne pas placer d’accent sur
les capitales d’un texte courant ? J’en trouve pourtant
deux : je trouve particulièrement laids les À que
l’on trouve de plus en plus souvent dans les livres et la
presse.
OUDIN-SHANNON :
Il n’existerait aucun argument pour ne pas placer d’accent sur
les capitales d’un texte courant ? J’en trouve pourtant
deux : je trouve particulièrement laids les À que
l’on trouve de plus en plus souvent dans les livres et la
presse.
![]() « Argument »
irréfutable… et dont les conséquences s’étendent à toutes les
majuscules accentuées, « laides » ou non ?
« Argument »
irréfutable… et dont les conséquences s’étendent à toutes les
majuscules accentuées, « laides » ou non ?
![]() OUDIN-SHANNON :
L’interlignage. Si l’on veut accentuer les capitales il faut
interligner suffisamment pour que les accents des capitales ne
touchent pas les jambages de la ligne supérieure. Ce n’est pas
toujours possible dans la composition d’un quotidien ou d’un
magazine par exemple.
OUDIN-SHANNON :
L’interlignage. Si l’on veut accentuer les capitales il faut
interligner suffisamment pour que les accents des capitales ne
touchent pas les jambages de la ligne supérieure. Ce n’est pas
toujours possible dans la composition d’un quotidien ou d’un
magazine par exemple.
![]() Comme
c’est impossible avec les À… il y a fort à parier que ce le soit
également avec É. Conclusion : on n’accentue aucune
majuscule ? C’est cela qu’il fallait comprendre ? C’est
cela que vous considérez comme la tradition française en la
matière ?
Comme
c’est impossible avec les À… il y a fort à parier que ce le soit
également avec É. Conclusion : on n’accentue aucune
majuscule ? C’est cela qu’il fallait comprendre ? C’est
cela que vous considérez comme la tradition française en la
matière ?
![]() OUDIN-SHANNON :
Depuis les débuts de l’imprimerie, les livres sont composés en
France à 99 % sans accent sur les capitales.
OUDIN-SHANNON :
Depuis les débuts de l’imprimerie, les livres sont composés en
France à 99 % sans accent sur les capitales.
![]() Si
l’on cessait de balancer des énormités, le débat serait plus
limpide et aurait, peut-être, une petite chance d’être utile.
Si
l’on cessait de balancer des énormités, le débat serait plus
limpide et aurait, peut-être, une petite chance d’être utile.
![]() OUDIN-SHANNON :
Affirmer qu’il faut toujours accentuer les capitales me semble
une position dogmatique qui ne tient pas compte de tous les cas
de figure.
OUDIN-SHANNON :
Affirmer qu’il faut toujours accentuer les capitales me semble
une position dogmatique qui ne tient pas compte de tous les cas
de figure.
![]() Alors
qu’affirmer que 99 % des livres composés en France depuis les
débuts de l’imprimerie sont sans accent sur les capitales serait
une observation documentée, sereine et non dogmatique…
Reparlons-en le 1er avril, ce sera plus adéquat.
Alors
qu’affirmer que 99 % des livres composés en France depuis les
débuts de l’imprimerie sont sans accent sur les capitales serait
une observation documentée, sereine et non dogmatique…
Reparlons-en le 1er avril, ce sera plus adéquat.
![]() OUDIN-SHANNON :
Je crois que l’argument esthétique : les capitales
accentuées sont plus hautes et « cognent » avec la
lettre, ne tient pas la route. (Ceux qui préconisent les À
sont mal placés pour avancer cet argument…)
OUDIN-SHANNON :
Je crois que l’argument esthétique : les capitales
accentuées sont plus hautes et « cognent » avec la
lettre, ne tient pas la route. (Ceux qui préconisent les À
sont mal placés pour avancer cet argument…)
![]() Alors
que ceux qui considèrent comme leur argument premier que le À est
« laid » sont évidemment bien placés pour jauger la
validité des arguments « esthétiques »… Il se trouve,
par bonheur, que le parasitage causé par les ponctuations hautes
ne constitue pas un argument d’ordre « esthétique ».
Alors
que ceux qui considèrent comme leur argument premier que le À est
« laid » sont évidemment bien placés pour jauger la
validité des arguments « esthétiques »… Il se trouve,
par bonheur, que le parasitage causé par les ponctuations hautes
ne constitue pas un argument d’ordre « esthétique ».
![]() OUDIN-SHANNON :
Dire que 99 % des livres étaient composés sans accent sur les
capitales serait une énormité ?
OUDIN-SHANNON :
Dire que 99 % des livres étaient composés sans accent sur les
capitales serait une énormité ?
![]() Oui,
sans l’ombre d’une hésitation, même si le changement de temps
semble indiquer un léger et prudent recul… Je répondais à
ceci : « Depuis les débuts de l’imprimerie les livres
sont composés en France à 99 % sans accent sur les
capitales. » La modification ne change rien :
l’assertion demeure erronée.
Oui,
sans l’ombre d’une hésitation, même si le changement de temps
semble indiquer un léger et prudent recul… Je répondais à
ceci : « Depuis les débuts de l’imprimerie les livres
sont composés en France à 99 % sans accent sur les
capitales. » La modification ne change rien :
l’assertion demeure erronée.
![]() OUDIN-SHANNON :
En fait, je crois qu’aucun livre n’avait d’accent sur les À,
Ô, Ù, etc.
OUDIN-SHANNON :
En fait, je crois qu’aucun livre n’avait d’accent sur les À,
Ô, Ù, etc.
![]() C’est
inexact.
C’est
inexact.